INTRODUCTION
D'importants événements ont marqué l'économie algérienne durant l'année écoulée avec, en première ligne, la mise en oeuvre du plan de soutien à la relance économique du Président Bouteflika, la réforme des textes de lois sur l'investissement et la privatisation, le paraphe de l'accord d'association avec l'Union européenne et la reprise des négociations pour l'adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce. Autant d'éléments qui marquent le ferme engagement de l'Algérie pour une économie de marché. " Le programme du nouveau gouvernement adopté récemment par le Parlement tire sa substance du programme de Monsieur le Président de la République qui lui-même s'articule autour de deux axes fondamentaux ; le premier étant l'approfondissement du processus des réformes économiques, alors que le second porte sur la modernisation du fonctionnement des différentes structures de l'Etat, afin de les rendre plus aptes à répondre aux aspirations des citoyens pour une meilleure gouvernance, pour plus de liberté, de démocratie et pour une meilleure répartition de la richesse nationale. L'action du gouvernement s'inscrit naturellement dans ce cadre et vise, en dernier ressort, à conforter la notion de citoyenneté par la promotion des libertés individuelles et collectives et à renouer l'économie algérienne avec le cycle de la croissance et du développement. ", explique Mr. Benflis, Chef du gouvernement de la République Démocratique et Populaire algérienne. Le gouvernement a, en effet, pris les premières mesures constituant une suite logique à la stabilisation du cadre macro-économique. Celle-ci a été entamée lors de l'application du plan d'ajustement structurel (1994-1998) et s'inscrit dans une logique de détente budgétaire et d'encouragement à l'investissement. Le plan de relance économique s'étale de 2001 à 2004, et jouit d'une enveloppe totale de 7 milliards de dollars, en majorité consacrée à la réalisation d'infrastructures et d'équipements divers.

La bonne conjoncture financière du pays est donc mise à profit. En effet, grâce à la bonne tenue du marché pétrolier lors de cette même période, les réserves de changes s'élèvent à 18 milliards de dinars et l'inflation, qui avait été ramenée à 0,9% en 2000, a subi une remontée de deux points en 2001. Cependant, la croissance reste faible, se limitant à 2,3% seulement, alors que l'ensemble des institutions financières internationales recommandent à l'Algérie un taux de 6 à 7% sur plusieurs années, pour résoudre ses problèmes économiques.
Après une décennie d'instabilités politiques, de crises économiques et sécuritaire, l'Algérie s'ouvre donc progressivement au monde. Près de 75% de sa population a moins de 35 ans, mais malgré cette inestimable force vive, des zones d'ombres subsistent: un taux de chômage de 30%, un déficit en logements de 2,1 millions d'unités, un taux d'analphabétisme de 23% et surtout un très faible pouvoir d'achat, avec un salaire minimum équivalent à 100 USD (8.000 dinars algériens). Autant dire que tout reste à faire, mais le pays peut compter sur ses innombrables potentialités pour combler ses lacunes. Aujourd'hui, après trois décennies d'économie administrée, l'Etat n'est plus en mesure de contenir la demande sociale. Malgré les bonnes performances financières, le gouvernement est tenu à adapter l'environnement économique aux règles du marché. La phase actuelle est donc celle des réformes dites de deuxième génération, dont le but est de faire de l'Algérie un pays concurrentiel, avec une liberté d'initiative et d'investissement. Le pari est difficile à tenir, sans un apport considérable en investissements directs étrangers.
C'est dans cette optique que le programme de soutien à la relance économique vise à offrir plus d'infrastructures à l'investissement productif (travaux publics, électrification, hydraulique, etc.). Parallèlement, deux nouveaux textes de loi sur l'investissement et la privatisation ont été promulgués en août 2001 ; ils incluent de larges facilités et incitations aux capitaux privés, nationaux ou étranger, ainsi qu'une fiscalité et des contraintes administratives assouplies. Le processus de libéralisation a, quant à lui, enregistré des résultats encourageants, notamment dans les secteurs des services et dans celui des transports.
Ces mutations correspondent à une nouvelle étape, mais aussi à de nouvelles mentalités, notamment avec l'essor du secteur privé. Dynamiques, ouverts et surtout de plus en plus organisés, les opérateurs privés ont détrôné les entreprises publiques ; ils génèrent plus de la moitié des richesses, hors hydrocarbures, et englobent plus de deux tiers de l'emploi. " Tout observateur, averti de la vie économique algérienne, peut témoigner de l'apparition, ces dernières années, de la culture d'entreprise, ainsi que d'une nouvelle génération de managers résolus à imposer le produit algérien dans les circuits commerciaux mondiaux, tournant ainsi le dos à une politique de repli sur soi. " , remarque le Premier ministre Benflis. Pour cette nouvelle génération de managers, le défi majeur à relever est l'accession à un taux de croissance élevé qui permettrai une progressive résorption du chômage.
TRAVAUX PUBLICS
Immenses chantiers en perspective
S'il est bien des secteurs indispensables au développement de l'investissement, qu'il soit national ou étranger, il s'agit bien de ceux relatifs aux Travaux publics et aux Transports. Le gouvernement algérien l'a bien compris, en avalisant l'application d'un ambitieux programme de relance économique qui, entre 2001 et 2004, devrait permettre d'importants efforts investissements. Il est vrai, à ce propos, que les retards en la matière sont énormes. Dans le domaine des travaux publics, seules les plus importantes régions disposent d'autoroutes ; les petites et moyennes agglomérations ne disposent que de routes étroites, en manque d'entretien. Quant au projet de l'autoroute est-ouest reliant la Tunisie au Maroc, annoncé à la fin des années 80 avec la création de l'Union du Maghreb Arabe, il stagne. D'autres infrastructures, telle la construction de barrages, représentent aujourd'hui une autre priorité de l'Etat ; l'accès à l'eau étant encore l'une des principales préoccupation de la population contrainte de subir, depuis deux décennies, les aléas de sécheresses chroniques. De son côté, la croissance des sept ports commerciaux et de la vingtaine d'aéroports du pays nécessite plusieurs projets d'extension. L'heure est donc à l'engagement de grands travaux pour combler le retard accumulé, et ainsi entrer concrètement sur le chemin de la croissance économique. " Au cours des dix dernières années, notre pays s'est plus préoccupé de la maîtrise des coûts que de l'amélioration des infrastructures de base. Aujourd'hui, avec ce programme de relance, nous rattrapons une partie du retard ", assure Mr.Medelci, ancien ministre des finances.
Projet d'autoroute est - ouest et Transaharienne
Le ministère des Travaux publics a pour mission de réunir les conditions de réalisation d'un certain nombre de projets stratégiques pour le développement de l'économie et l'amélioration des conditions de vie en Algérie. Mr.Abdelmalek Sellal, ancien ministre des Travaux publics et actuel ministre du transport, insiste en particulier sur les grands projets d'autoroutes, la Transaharienne et celle reliant les pays du Maghreb d'est en ouest. Les travaux de cette dernière ont été lancés en 1987. Prévu sur une distance totale de 1216 km, reliant El Tarf, sur la frontière tunisienne, à Maghnia, sur la frontière marocaine, seuls quelques 100 km ont été réalisés à ce jour. Signe de l'assouplissement des procédures en matière d'investissement privé dans les infrastructures publiques, le gouvernement algérien envisage maintenant l'assistance de grands groupes étrangers, qui obtiendraient un droit d'exploitation, en contre-partie de leur participation. En effet, le financement de telles infrastructures dépasse largement les capacités du seul Etat algérien, simultanément engagé sur plusieurs front. Ce projet d'autoroute est considéré en Algérie comme le chantier du siècle, avec un coût estimé à prés de 6 milliards de dollars pour la construction des tronçons restants. Mr. Sellal invite les entreprises de travaux publics à se manifester: " On ne peut faire face seul ; nous avons besoin d'apports extérieurs. Les modalités pour que des entreprises puissent réaliser une partie des projets à mettre en œuvre sont diverses. Il peut s'agir d'une réalisation directe ou d'un partenariat, voire d'un BOT (Build, Operate, Transfer) en matière de réalisation et gestion ". Plusieurs multinationales seraient intéressées par cette dernière formule, qui consiste en la construction de tronçons, en leur exploitation sur une longue durée, puis en une rétrocession des infrastructures routières à l'Etat algérien. M. Sellal a, par ailleurs, précisé que son ministère allait rapidement entamer de premières consultations avec une firme américaine dans cette direction. Le coût extrêmement élevé d'un tel projet reste néanmoins, pour le moment, le grand frein à l'avancée rapide des travaux. Les perspectives sont cependant alléchantes. De fait, toujours selon les dires du ministre Sellal, " l'autoroute algérienne est beaucoup plus rentable, avec une moyenne de près de 20.000 véhicules/jour, alors que les pays voisins, dans les meilleures des cas, n'enregistrent que 4000 véhicules/jour. "
Invitation au partenariat

Mr. Mohamed Hocine Ahriz, P.D.G. de la Sapta, une importante entreprise présente dans les secteurs de la construction et des Travaux publics, estime que l'ouverture du marché algérien a abouti à une étonnante croissance de la concurrence. Dans ce cadre, " les entreprises étrangères peuvent soumissionner si elles le veulent les contrats en dinars, en vertu de la liberté de change. Avant, ces sociétés n'étaient pas intéressées par la conclusion d'un contrat si les projets n'étaient pas financés par un organisme international " remarque le P.D.G de la Sapta. La concurrence s'amplifie donc pour le plus grand bien du marché ; notamment celle des entreprises asiatiques, de plus en plus présentes dans les secteurs de la construction et des Travaux publics en Algérie.
L'investissement s'oriente également vers une prise de participation dans le capital des entreprises de Travaux publics. " Lorsqu'un investisseur étranger est intéressé par une entreprise publique, nous sommes prêts à discuter de l'ouverture de son capital. Une prise de position dans la structure pouvant se traduire en terme de représentation au sein de l'entreprise privatisée en question ". Selon Mr.Sellal, ces ouvertures de capital peuvent aller jusqu'à 40%. Ainsi Cosider, une entreprise publique leader national du secteur, est actuellement en partenariat avec plusieurs entreprises et souhaite l'ouverture de son capital. " Cosider estime que la conjugaison des efforts et l'association des intérêts entre public et privé est nécessaire. (…) notre ambition est de nouer des relations durables avec des partenaires ayant des perspectives à long terme. La dimension du marché intérieur algérien et sa solvabilité, ouvrent de grandes perspectives de coopération dans la complémentarité des compétences et des moyens ", affirme Mr.Abdelwahid Bouabdallah, P.D.G. de Cosider. Sonatro est, elle aussi, une entreprise évoluant dans ces mêmes secteurs de la construction et des Travaux publics. Présente sur l'ensemble du territoire national, cette société s'est développée remarquablement dans les années 70 au point de donner naissance en 1983 à cinq entreprises routières ainsi qu'une spécialisée en ouvrage d'art. Passée à l'autonomie en 1991 et malgré une conjoncture et un environnement devenus très difficiles, la Sonatro continue de réaliser de grands projets qui font d'elle un partenaire incontournable dans le secteur des Travaux Publics. Pour sa part, Mr.Rebbouh, P.D.G. de la Société Nationale de grands Travaux Routiers (Sonatro), confirme l'importance du partenariat pour son entreprise: "Nous voulons renforcer notre force de frappe, c'est la raison qui nous amène à rechercher un partenariat ; l'intéressé devra venir avec les moyens matériels et financiers (…) Nous avons la maîtrise du terrain, nous pouvons offrir le plan de charge et aussi la connaissance de l'administration, ce qui représente un point important".
Khalifa à l'assaut du BTP
Un bel exemple de l'intérêt du secteur privé envers l'énorme marché que représente le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en Algérie, est celui du groupe Khalifa. Celui-ci a, en effet, récemment pris le contrôle de l'entreprise Philipp Holzmann, ex numéro trois du BTP en Allemagne. Le premier groupe privé algérien acquiert ainsi le savoir-faire qui lui faisait défaut dans le domaine du BTP, en profitant de la défaillance d'une grande entreprise européenne. Avec les ressources de Holzmann International, Khalifa a désormais les compétences pour se lancer dans des projets d'envergures, tels la construction de l'aéroport de Bouzghoul ou encore, celui pharaonique de la construction d'une nouvelle ville, Algéria, au milieu du désert, ayant pour objectif de désengorger Alger.
De grandes perspectives s'ouvrent donc à ce secteur des Travaux publics qui sera, dans les prochaines années, fort sollicité dans le cadre de la nécessaire mise à niveau des infrastructures du pays. Routes, barrages, aéroport, infrastructures en tous genres ; d'immenses marchés sont à portée de mains. A elles seules, les entreprises algériennes de Travaux publics ne suffiront évidemment pas pour couvrir cet immense chantier. L'appel au partenariat, à l'investissement privé est donc plus que jamais lancé.
Parallèlement à ces constatations, le secteur des BTP, grand consommateur de main d'œuvre, constitue peut être une solution, pour résorber partiellement l'important taux de chômage enregistré actuellement. Autant dire que le gouvernement accorde une attention particulière à ce secteur capital, indispensable au développement futur de l'Algérie.
TRANSPORT
A la pointe des libéralisations
Le Transport est un des domaines où la libéralisation a le plus avancé. De 1998 à 2001, trois nouveaux textes sont venu marquer cette tendance générale, à savoir le nouveau code de navigation aérienne, le nouveau code maritime et la loi sur les transports terrestres.Il faut reconnaître que le secteur des Transports est vital au bon fonctionnement de l'économie du pays, car il affecte de manière quasi directe, tous les créneaux d'activités. Comme pour la majorité des différents pans de l'économie algérienne, les Transports doivent subir une réformes structurelle et législative afin de s'adapter aux nouvelles exigences d'un marché libéralisé, soucieux du bien être de ses concitoyens et du bon déroulement de l'activité économique. D'autre part, afin de stimuler l'investissement, il est capital de consolider et d'étendre les infrastructures existantes.
S'il nécessite des amélioration, le réseaux algérien, est cependant déjà fort diversifié et étendu. Le transport routier est prédominant et prend en charge 90% du trafic intérieur. Le transport ferroviaire joue, lui, un rôle important pour la desserte des ports, des zones industrielles et des grands centres urbains. Malgré un fort potentiel, son utilisation reste malheureusement limitée, avec 7 à 8% du marché, marchandises et passagers confondus. Sans doute les assauts terroristes sur les convois ont-ils leur part de responsabilité dans cette situation. Fort de ses 68 navires marchands, le transport maritime monopolise, quant à lui, la quasi-totalité du commerce extérieur. Enfin, le transport aérien connaît un accroissement significatif de ses activités.
Vols nationaux: près de 50% de croissance en 2001
Pour le transport aérien, la compagnie privée Khalifa Airways a confirmé son statut de concurrent direct de la compagnie nationale Air Algérie. La compagnie publique, qui se donne deux années pour ouvrir son capital, est en contact avec la banque conseil BNP Paribas pour l'accompagner dans ce processus. Elle a déjà signé un accord d'alliance stratégique avec Alitalia, mais c'est surtout son partenariatavec Khalifa Airways qui donne un aperçu de la détermination des deux compagnies à s'implanter sur le marché européen, ainsi que leur volonté de conserver leurs parts de marché locales.
En effet, la venue d'Air Lib et d'Air Littoral a stimulé une concurrence certaine sur les destinations françaises qui représentent le gros des vols internationaux à partir de l'Algérie. " L'année 2001 a connu une évolution appréciable, principalement pour les vols nationaux. Avec l'avènement de la compagnie Khalifa, nous avons connu un boom assez significatif ", explique Mr. Ait Si Ali Mouloud, Directeur général de l'Entreprise Nationale de Navigation Aérienne (ENNA). Chiffres à l'appui, Mr. Daoud, responsable à l'ENNA, confie cependant, qu'au lendemain des événements du 11 septembre, l'activité des vols internationaux sans escales a connu une baisse significative de 15%.
" Cette tendance s'estralentie au premier semestre 2002. Pour ce qui est des vols nationaux, sur l'ensemble de l'année 2001, nous avons enregistré une augmentation très forte, de l'ordre de 45% à 50% ".Le secrétaire général du groupe Khalifa, Rachid Amrouche, abonde dans le même sens. " Dès le début, notre stratégie donnait la priorité au marché domestique et ensuite au marché international. Nous sommes maintenant arrivés à un maillage de toute l'Algérie.

Pour ce qui est de l'international, nous poursuivons la réalisation de notre objectif qui consiste à suivre les mouvements économiques du pays ainsi que notre population émigrée. Ainsi après l'installation de nos escales dans plusieurs villes françaises, espagnoles, à Johannesburg et à Dubaï, nous venons d'être autorisés à desservir Casablanca, Tunis, Damas, la Mecque, Istanbul, Milan et Londres. Nous comptons aussi couvrir prochainement l'Amérique du Nord ". Gestionnaire de dix aéroports à l'ouest du pays, l'EGSA d'Oran, par la voix de son directeur général, Mr. Djellat, constate cette expansion du marché, facteur de croissance de son entreprise. " Il y a deux ans, nous avons réalisé une nouvelle extension au niveau de l'aéroport d'Adrar ; cela nous a permis de doubler les capacités d'accueil. Par ailleurs, l'année passée, nous avons entrepris des travaux d'agrandissement à de l'aéroport de Béchar. Cette modeste réalisation, faite avec nos propres moyens, nous a permis de doubler la capacité de traitement des passagers.
Enfin, pour les réalisations actuelles, nous avons entamé le premier avril l'extension de la deuxième plate-forme de l'ouest, à savoir Tlemcen, dont l'inauguration a eut lieu le 20 août de cette année. Nous avons ainsi pu libérer des espaces au niveau de l'aérogare internationale d'Oran, qui vont générer des ressources nous permettant de nous autofinancer, et de réaliser d'autres projets sur les différentes plates-formes à plus faible revenu ". L'EGSA d'Oran ne fera pas cavalier seul, ajoute Mr. Djellat " nous avons lancé l'avis d'appel d'offre pour la réalisation de la zone terminale dans son ensemble, aussi bien l'aérogare que la tour de contrôle ainsi que les autres structures pour les différents opérateurs. Nous avons également l'aéroport de Mascara où nous avons lancé un avis d'appel d'offre avec d'autres transporteurs aériens ". Le partenariat n'intervient que là où l'entreprise ne dispose pas de l'expérience suffisante. " Nous avons fait notre première expérience de partenariat avec des sociétés dans le domaine du catering, du management et de la gestion proprement dite.
La première concrétisation s'est réalisé dans le domaine des free shops, très recherchés par les passagers. Nous avons concrétisé avec une société suisse, Ed Mauer, pour les aéroports internationaux d'Oran et de Tlemcen ". Enfin, il faut retenir la mise en concession de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport Houari Boumédiène d'Alger, pour laquelle un appel d'offre a été lancé le 12 juillet 2001. C'est la première fois qu'une infrastructure publique fait l'objet d'une concession à un exploitant privé en Algérie. Ce dernier aura pour mission de terminer les travaux de construction de la nouvelle aérogare, dont le chantier a débuté il y a plus de dix ans. Cette nouvelle aérogare portera la capacité de l'aéroport à près de 8 millions de passagers par an. L'aéroport d'Alger a enregistré l'an dernier un trafic de près de 4,3 millions de passagers, avec une forte hausse aussi bien du trafic national (+ 40,8% en 2001 par rapport à 2000) que du trafic international (+17,6%).
Le secteur maritime en appel aux investisseurs
Avec un quasi-monopole du commerce extérieur, le transport maritime devait impérativement s'adapter au nouveau contexte du commerce international. C'est dans ce cadre que le code maritime a subi un examen systématique, afin de l'adapter aux nouvelles exigences du marché. Un autre impératif, dans ce contexte d'ouverture au monde, consiste en la modernisation des infrastructures portuaire. En ce qui concerne le réaménagement de la gestion de l'activité portuaire, on notera la mise en place de trois autorités, devant prendre le relais de l'Etat. Il est maintenant stipulé que les opérations commerciales, tant privées que publiques, se dérouleront dorénavant dans un cadre concurrentiel.
Le secteur maritime est donc ouvert à l'initiative privée depuis la mise en place des nouvelles réformes. Les investisseurs restent cependant timides vis à vis de ce créneau, compte tenu du niveau des crédits à mobiliser pour créer des services de transport maritime. Quatre opérateurs et dix entreprises portuaires de statut public se partagent actuellement le marché. Toujours au niveau des activités portuaires, il est cependant relevant de mentionner le dynamisme de l'EPAN (entreprise portuaire d'Annaba).
Cette dernière joue un rôle clé dans le pôle industriel régional, dominé par les deux groupes industriels Asmidal et Ferphos. Selon M. Sahli, directeur général de l'EPAN, " L'ensemble des ports et des entreprises portuaires d'Algérie vont connaître une adaptation stratégique. Les activités commerciales (la manutention et le remorquage) seront des activités ouvertes à la concurrence et peuvent être exercés par d'autres entreprises. Les activités de gestion des domaines publiques relèveront de l'autorité publique qui aura la gestion de ces espaces ". Le plan de développement de l'EPAN porte notamment sur le développement des infrastructures." Nous venons de réaliser avec le concours de la Banque Mondiale le terminal polyvalent. En matière d'entretien de nos infrastructures de base, il y a un programme d'entretien et de rénovation dont le point culminant est celui qui se rapporte au dragage. En matière de manutention et en manière de remorquage cela interviendra probablement à très brève échéance ".
Donnant d'autres exemples de l'ouverture du secteur maritime, Mr. Nazef, secrétaire général au ministère des transports, souligne que " pour ce qui est des ports, il y a une tendance à la libéralisation et à une ouverture puisqu'il y a des mises en concessions d'espaces commerciaux à l'intérieur des ports ". Le port de Djendjen, fort de ses nombreux atouts, est dans ce cadre particulièrement attractif aux investisseurs. Mr. Nazef remarque, par ailleurs, qu'en ce qui concerne le secteur voyageurs, le Code maritime permet maintenant la possibilité d'utiliser un autre navire que ceux de l'Entreprise Nationale de Transport Maritime des Voyageurs (ENTMV) ; " Vous pouvez voyager avec la SNCM Corse Méditerranée, et il y a également la possibilité pour un investisseur de promouvoir sa propre société de transport maritime de voyages à côté de l'ENTMV ". Le port d'Alger est lui le premier port commercial d'Algérie avec une moyenne de trafic annuel de l'ordre de six millions de tonnes. Ce port assure donc près de 35% du trafic marchandises du pays, dominé essentiellement par les importations. Il reçoit en moyenne chaque année près de 2200 navires commerciaux à l'entrée. Enfin, le port d'Oran est celui qui voit passer la plus grande quantité de passagers en Algérie.
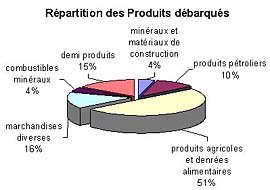
En ce qui concerne le chemin de fer, aucune intervention du secteur privé n'est enregistrée à ce jour, cette activité étant toujours réservée à un opérateur de statut public. La SNTF reste donc l'opérateur unique, jusqu'à ce qu'une décision soit prise pour la mise en concession du réseau ferroviaire. Un programme spécial a été voté pour la mise à niveau du chemin de fer qui a devant lui d'immenses perspectives, tant au niveau du transport de marchandises qu'à celui de passagers. En marge du secteur ferroviaire, celui du transport routier connaît, depuis sa libéralisation, une croissance sans précédent. Il est caractérisé par une offre supérieure à la demande et par une certaine anarchie, notamment dû à l'utilisation de matériels non-adaptés, qui a conduit à la mise en place d'un encadrement juridique plus stricte.
De grands projets
Quant aux grands projets, Mr. Nazef cite celui du tramway et du métro d'Alger comme deux importantes opportunités de partenariats. " Globalement, la politique des transports urbains est une politique tout à fait libérale. Il n'y a aucun monopole en la matière. Au contraire, nous souhaitons inciter à une contribution plus large du secteur privé ou une intervention combinée public/privé ". Ce projet qui nécessite un investissement considérable, notamment dû au relief accidenté de la capitale algérienne est pour le moment à l'étude. Celle-ci doit se pencher sur l'état actuel du projet et envisager les différentes alternatives, afin de concilier les impératifs économiques, sociaux et structurel, nécessaires à sa réalisation. En complément de ce projet de transport urbain, celui de l'extension du réseau ferroviaire à la grande banlieue algéroise est également à l'étude.
A l'heure de la libéralisation du marché algérien, le ministère des Transports accorde une attention particulière à l'amélioration de ses infrastructures. A cet effet, un programme de relance, touchant tous les secteurs concernés, a donc été lancé. Celui-ci tient compte des exigences indispensables à la mise en place d'un réseau de transports performant et sécurisé. Les aéroports, les ports, le chemin de fer, les transports maritimes et aériens doivent s'adapter aux nouveaux impératifs d'une économie ouverte au monde. Le niveau de performance, la qualité des services et les conditions de sécurité doivent sensiblement s'améliorer, tout en veillant à appliquer des coûts concurrentiels. Toutes ces mesures d'adaptations et de restructurations sont autant d'appels au soutien technique et financier d'investisseurs privés, notamment internationaux.
POSTE ET TELECOMMUNICATIONS
Intégrer les nouvelles technologies
l'Algérie comprend le plus faible taux de couverture à l'échelle africaine. Seul 5% de la population dispose d'un téléphone, alors que l'on compte près de 700.000 demandes en instance pour le téléphone fixe et 200.000 pour le mobile (chiffres de 1999). Une récente étude a, par ailleurs, fixé la demande potentielle d'abonnés solvables à 7 millions pour la téléphonie fixe, et à 5 millions pour la téléphonie mobile. A l'horizon 2010, on devrait connaître une télé-densité de 25% en fixe et de 30% en mobile. L'Etat vient de lancer, quant à lui, un appel d'offre pour l'élaboration d'une étude sur le marché des télécoms Algérien afin de mieux en cerner le développement. Au vu du retard technologique pris par ce secteur, l'appel au capital privé a permis l'entrée sur le marché d'un nouvel opérateur, le l'Egyptien Orascom, pour la mise en place et l'exploitation de la deuxième licence GSM, ce qui a révolutionné un marché monopolistique, placé sous la responsabilité du ministère des Postes et Télécommunications. Une troisième licence d'exploitation sera proposée vers 2003, année qui verra aussi la mise en compétition du marché du téléphone fixe. Par ailleurs, de grands équipementiers se placent déjà sur le marché, dont Siemens, Motorolla et Ericsson.
La refonte des Télécommunications
Le secteur des postes et télécommunications fait aujourd'hui l'objet d'une reforme en profondeur, dont le but est d'assurer la compétitivité de ses organes à l'heure de l'ouverture et de la diversification de l'économie algérienne. Cette réorientation stratégique doit veiller avant tout à assurer un meilleur service aux citoyens. C'est dans ce but que les grands axes du programme gouvernemental s'articulent, principalement, autour de la refonte du cadre législatif et réglementaire du secteur de la poste et des télécommunications, pour asseoir ses reformes sur une base solide, transparente et sûre. Dans le cadre de l'ouverture de cet important marché à la concurrence, l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) veille à la mises en place effective des réformes, ainsi qu'au respect des procédures.
Depuis la nouvelle loi élaborée en 2000, l'ancienne structure étatique regroupant la gestion de l'ensemble des activités des secteurs de la Poste et des télécommunications est maintenant scindée en deux entreprises distinctes ; Algérie télécoms et ses filiales associées: Mobilis pour le téléphone cellulaire et Djaweb pour l'Internet ; et une entreprise publique à caractère industriel et commerciale, Algérie Poste et sa filiale Sarii Post pour le courrier express. Il s'agit là du premier secteur qui a été ouvert à la concurrence, en 1994, avec l'installation de DHL International. FEDEX comme UPS ont retiré le cahier des charges après le lancement d'un appel à manifestation d'intérêts par l'autorité de régulation des Postes et Télécommunications. Parlant de ce marché concurrentiel, Mr.Rezzoug, directeur général de DHL, remarque que " l'Algérie est un pays à fort potentiel où les investisseurs peuvent bénéficier de beaucoup d'avantages tels que l'exonération d'impôts, ainsi que la facilité douanière et fiscale, qui est le leitmotiv de la promotion de l'investissement. ". Et le dirigeant de DHL ajoute encore que " la privatisation du secteur des télécommunications va par ailleurs conduire à une amélioration considérable de ce marché".
Djaweb est lui le nouveau fournisseur d'accès Internet offrant une gamme de services complète et élaborée, avec des prix concurrentiels et une relativement bonne couverture du territoire national. Si le réseau Internet est loin d'être présent dans tous les foyers, il est aujourd'hui accessible à tous, le ministère ayant largement supprimé les contraintes pour l'ouverture de cyber cafés, inexistants il y a encore moins de trois ans et actuellement omniprésents. Dans ce secteur, quatre providers privés (Gecos, Eepad qui est en partenariat avec Wanadoo, Solinet et Icos.net) sont venus concurrencer l'opérateur public Cerist, tandis que le ministère vient de lancer une ligne d'accès sans abonnement. Selon une étude faite en 2001, près de 6.000 entreprises sont connectées à Internet, instrument qu'elles n'utilisent même pas dans toutes ses possibilités (messagerie interne, sites interactifs,etc.).
Appels aux partenariats
Algérie Télécoms détient la première licence GSM et s'est associé avec Ericsson pour le lancement de 500.000 lignes au cours de cette année. Mais les perspectives d'Algérie Télécoms vont au-delà de ces prévisions, comme l'explique son P.D.G., Monsieur Messaoud Chettih:
"Dans le secteur des télécoms, il est admis et reconnu que les marchés porteurs sont ceux du Maghreb, car ils sont en pleine phase de développement. Il y a un intérêt pour les opérations de partenariat, mais nous les voyons différemment. Nous voulons aller au-delà du simple achat d'équipements et d' installations. Nos partenaires doivent comprendre et agir dans cette perspective ". Et Messaoud Chettih précise encore: " le problème des télécoms est celui de l'offre et non pas de la demande. Nous sommes loin de satisfaire les besoins exprimés. Il faut qu'Algérie Télécoms réagisse rapidement, même si la situation est confortable ; la concurrence va venir et c'est peut-être elle qui se chargera de satisfaire ces besoins. (…) Algérie Télécoms a besoin d'un partenaire stratégique avec une ouverture de capital à hauteur de 30% ; l'entreprise a aussi besoin d'un apport technologique et managerial. Le partenariat étant essentiel, plusieurs sociétés comme Telefonica et France Télécoms ont montré un certain intérêt pour le marché algérien. (…) Algérie Télécoms venant d'être créée, le ministère ne pouvait pas engager des alliances autres, que celles qui consistent à s'approvisionner en matériels. Mais cela devrait se concrétiser avec le GSM, l'Internet et le transport de l'image. " Mr. Chettih a de quoi être optimiste, car Algérie-Télécoms, pour le moment, se place loin devant la concurrence.Au vu de la spécificité du service public, l'évolution des services postaux pourrait, quant à elle, ne pas connaître la même croissance. Même si la Poste reste un vecteur important pour les échanges financiers et le courrier, avec un total de 5 millions de comptes courants, son mode de fonctionnement reste en deçà des standards internationaux, notamment en termes de délais et de diversité des services.Mais la Poste n'en demeure pas moins une opportunité des plus intéressantes. " Le secteur des services, notamment la Poste, demande des investissements conséquents, c'est pour cette raison que nous sommes ouverts à tous types de partenariats qui pourraient améliorer et développer notre créneau. (…) Des réformes ont été menées avec l'appui de la Banque Mondiale qui a accordé un prêt de 9 millions de dollars.
Dans le cadre de ce prêt, une étude est planifiée pour évaluer les possibilités de revalorisation de la ressource humaine et optimiser l'organisation de la Poste, notamment en se basant sur les technologies de l'information. Nous bénéficions également du projet MEDA, du fond de l'Union européenne qui servira au développement de la Poste ". explique Mme Ghania Houadria, Directrice générale d'Algérie Poste. De nombreux pas en avant ont déjà été accompli par cette entreprise qui constitue la première banque du pays, et qui prend en charge la gestion du courrier de toutes les sociétés dispensant des services publics (eau, téléphone, gaz, électricité). C'est ainsi qu' Algérie Poste compte lancer son propre service épargne, moderniser sa gestion en introduisant l'usage des nouvelles technologies (à l'image de la consultation des comptes par Internet, déjà mise en place) et perfectionner le courrier express au plan national et international. Il s'agit encore là de projets soutenus par la Banque Mondiale et l'Union Européenne à travers des programme d'assistance technique. Algérie poste devrait donc connaître un nouvel essort ces prochaines années.
Le marché algérien est l'un des plus importants de la région. C'est un marché important non seulement pour le Maghreb et l'Afrique, mais également pour l'ensemble des pays riverains de la méditerranée et pour l'Europe en général. Avec une population de 32 millions, majoritairement composée de jeunes, l'Algérie est un marché réceptif aux nouvelles technologies de l'information et la communication. L'importance de la demande en instance en téléphonie fixe et mobile et d'accès à l'Internet en est, d'ailleurs, la meilleure preuve.
D'autre part, des projets d'envergure internationale sont envisagés dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes économiques stratégiques, tels que les futurs gazoducs qui relieront directement Alger à l'Espagne et à l'Italie. Il est évident que ces gazoducs s'accompagneront de systèmes de télécommunications de haute fiabilité et dont les capacités pourraient éventuellement être adaptées pour la prise en charge des besoins d'un grand nombre de pays africains. L'Algérie lancera, par ailleurs, dès cette année le premier d'une série de quatre satellites satellite, ALSAT 1. Ceux-ci seront dédiés à la météo, à la télédétection, à la messagerie courte et à la formation. L'Algérie entend ainsi concrétiser rapidement le droit à communiquer de tous les algériens, quel que soit leur situation et leur lieu de résidence.
FINANCES
Les banques en mouvement
Afin de soutenir l'ensemble des reformes mises en route par le gouvernement, une refonte du secteur financier était indispensable. Aujourd'hui, le système algérien compte quelques 20 banques commerciales en marge de la Banque centrale, trois bureaux de représentation de grandes banques internationales, une bourse des valeurs, une société de refinancement hypothécaire, des caisses d'assurance-crédit, etc.

Le secteur bancaire publique domine toujours le marché, malgré une montée en puissance remarquée du privé. L'intervention des banques dans le financement des activités économiques a, par ailleurs, évolué de manière significative. Mr. El-Hachemi Meghaoui, P.D.G. du Crédit Populaire d'Algérie (CPA) affirme: " Le secteur bancaire est engagé dans une mutation qui devrait se traduire par une bancarisation plus importante et par des opérations plus rapides. La modernisation devrait également s'accélérer par la mise en oeuvre de partenariats avec les institutions bancaires et financières internationales. Le plan de relance de l'économie et de privatisation offre en outre d'autres opportunités, notamment dans l'ingénierie financière, le montage financier des grands projets et le développement de financement type leasing ou capital-risque ".
Ouverture de capital jusqu'à 100%
Arriver à une qualité des services est aujourd'hui devenu possible, au terme d'un long processus d'assainissement de la trésorerie des banques publiques, qui en est à sa dernière phase. Celles-ci renouent maintenant progressivement avec une situation d'équilibre pour mieux affronter la rude concurrence que mènent déjà les banques privées. Le contexte est également tout à fait différent, puisque, depuis la promulgation des nouveaux textes sur la privatisation et la gestion du secteur public, les banques d'Etat peuvent ouvrir leur capital jusqu'à 100% et ainsi accéder à une privatisation totale. C'est le cas du Crédit Populaire d'Algérie (CPA) qui, selon son P.D.G. Mr. El-Hachemi Meghaoui, a déjà pris la décision d'ouvrir son capital: " Depuis fin 1999, nous avons avancé dans notre réflexion et nous avons décidé, avec les orientations et l'accord de nos actionnaires, d'ouvrir le capital de la banque. Nous avons considéré que cela était nécessaire pour réaliser nos ambitions afin de devenir une banque ouverte aux marchés internationaux, et offrant à sa clientèle une diversité de produits disponibles au niveau international ". Une avancée dans ce sens est déjà perceptible à travers les nouveaux services dispensés par le CPA, à l'image du crédit immobilier, du crédit à la consommation et de celui pour les professions libérales. Quant au réseau informatique des différentes agences CPA, celui-ci a largement été perfectionné et fait actuellement l'objet d'un projet pour la mise en place d'une messagerie interbancaire. Par ailleurs, le CPA participe activement au programme d'amélioration du système de payement, par l'introduction de la carte de crédit.
Les mêmes ambitions sont affichées par la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR). Cette banque qui était à la base destinée à répondre aux besoins spécifiques du secteur agricole et rural, mais avec les changements d'orientation de la politique économique enregistré ces dix dernières années, a élargi ses activités pour venir en aide à d'autres secteurs. La banque s'adapte ainsi actuellement à la demande du nouveau marché. Tout dernièrement, elle a mis en place le concept unique de " banque assise " avec services personnalisés, permettant de mieux prendre en charge les hommes d'affaires et les porteurs de projets. Les premiers résultats de cette initiative sont déjà perceptible: d'importante sociétés ont rallié la BADR, dont Naftal, Sonelgaz, Sonatrach ou encore Orascom. Concernant l'entrée d'un partenaire dans le capital de la banque, Mr. Farouk Bouyacoub, P.D.G. de la BADR, indique que " La priorité est pour le moment la mise à niveau de la BADR, car il est avant tout préférable de négocier l'entrée en capital d'un partenaire étranger en position de force ".
Comme pour tous les secteurs de l'économie algérienne, celui des banques connaît un regain de l'activité privée. A ce jour, et depuis la libéralisation du secteur bancaire en 1991, on compte six banques privées algérienne, dont la plus connue, Khalifa Bank, a étoffé son réseau d'agences à travers le pays. C'est la seule banque à être universelle et à développer des services personnalisés comme la carte fidélité et le payement électronique. " El Khalifa Bank, dès sa création, a affiché sa stratégie qui vise à mieux servir sa clientèle en terme d'accueil, de qualité, de délais et d'offre de produits nouveaux. Ainsi nous disposons de guichets dont le modernisme des services tranche sur celui de la concurrence. Nous avons pu mettre à la disposition de l'ensemble des agents économiques un éventail de services bancaires destinés à un consommateur moderne. Pour cela, nous avons investi aussi bien dans les nouvelles technologies que dans le capital humain, afin de pouvoir servir notre clientèle avec célérité ", explique Mr. Rachid Amrouche, secrétaire général du groupe Khalifa. Quant aux banques étrangères, elles ont ouvert une vingtaine de succursales ces dernières années, telles la City Bank, Société Générale, BNP Paribas ou encore Exim bank ; elles participeront très certainement à doper le marché, tout en apportant ce nouveau souffle dont le secteur financier algérien a tant besoin.
Le tumulte bancaire
Au rythme de l'ouverture de son pays, la population algérienne va devenir de plus en plus exigeante envers son système bancaire, sans parler des investisseurs nationaux ou étrangers, qui ont impérativement besoin d'un soutien financier performant, dans le cadre de leurs opérations d'acquisitions et de partenariats ou encore dans celui de la privatisation. En effet, l'une des grandes appréhensions des économistes est de voir les entreprises privatisées, tout comme les nouveaux investissements, livrés à un secteur financier asséché et incapable de les accompagner. L'efficacité et la crédibilité des services bancaires est donc, maintenant, l'un des critères indispensable à prendre en considération dans le processus de réforme du système bancaire algérien. Le fait est, justement, que les banques d'Etat constituent l'un des rares secteurs où les réformes sont les moins perceptibles. L'accumulation de dettes dans la dernière décennie a entraîné un retard dans le processus de mise à niveau, tandis que la qualité des prestations, la rigidité sur les crédits (35 à 45 jours pour une lettre de crédit) et la lenteur des procédures continuent de freiner toute l'économie du pays. Il est, en effet, extrêmement préjudiciable que des transferts entre deux agences puissent monopoliser un à deux mois, que les transactions de fonds, entrants ou sortants, et devant impérativement passer par la Banque Centrale, durent entre un et deux mois et que, simple exemple, le chèque puisse encore être refusé lors d'un achat ou d'une transaction. Au regard de ces performances, un faible taux de bancarisation est enregistré dans les échanges, alors que la bureaucratie des banques d'Etat continuent de repousser une clientèle importante, mais encore méfiante à leur égard.
Assurances: inculquer la notion de risque
Le secteur des assurances connaît lui aussi, depuis la relance économique, un regain d'activité. Depuis 1995, une dizaine de compagnies privées d'assurances ont vu le jour, sans compter les agences qu'elles ont agréées. Plusieurs banques privées, constatant la rentabilité de cette branche, ont créé à leur tour leur propre filiale d'assurances, avec la perspective de quadrupler son chiffre d'affaires à l'horizon 2005. Selon une récente étude du Conseil National des Assurances (CNA), le marché est actuellement estimé à 250 millions de dollars/an ; ce qui, au regard des professionnels du secteur, est trop peu par rapport à ses réelles potentialités.
Toujours d'après les experts, il est nécessaire d'assouplir les textes au profit d'une plus grande libéralisation et lancer le chantier de la privatisation des compagnies publiques, telles que la SAA, la CAAR ou encore la CAAT. Mr. Mourad Medelci, ancien ministre des Finances, pense à, ce sujet, que la prochaine étape dans la réforme du système financier sera celle des assurances. Il estime par ailleurs que " le problème des assurances est lié aux mentalités locales qui ne sont pas familière avec la notion de risque, pourtant centrale dans une économie de marché. Le concept du risque doit gagner en clarté aux yeux des opérateurs économiques et des citoyens. Il est nécessaire d'introduire progressivement une culture et des croyances nouvelles pour que les opérateurs économiques, comme les citoyens, perçoivent la nécessité de s'assurer contre les différentes formes de risques, qu'elles soient sociales ou économiques ". Le secteur de l'assurance en Algérie offre un immense potentiel d'investissement.
Le P.D.G. de la Caisse Algérienne d'Assurance et de Réassurance (CAAR) affirme à ce sujet: " pour les investisseurs intéressés par le secteur des assurances,le marché est encore quasiment vierge. Je peux, par exemple, vous donner un chiffre: on peut évaluer le marché de l'assurance à un milliard de dollars en termes de potentialités or, nous en sommes actuellement à 250 millions de dollars. Voyez la différence à l'état actuel des choses. S'il y a des investisseurs qui rentrent, le marché sera beaucoup plus porteur ". La Compagnie française d'assurance du commerce extérieur (Coface) intervient, elle, en Algérie sous forme d'assurance-crédit court terme pour les biens de consommation, d'assurance-crédit moyen terme, d'assurance investissement et d'assurance construction. Cette institution estime maintenant que le " risque Algérie est acceptable ", c'est à dire que le pays est désormais plus fiable pour les investissements.
Bourse d'Alger: les balbutiements d'un rampant
Quelques compagnies d'assurances seront prochainement inscrites sur la liste des compagnies publiques à introduire à la Bourse d'Alger. Cette dernière, ouverte en 1998, ne fonctionne encore qu'avec quatre titres (les obligations de la Sonatrach et les actions de Saidal, Eriad-Sétif et El-Aurassi) et une seule séance de cotation hebdomadaire. Tout comme les actionnaires qui ont été nombreux à investir, le monde de la finance attend impatiemment que le marché soit re-dynamisé: vingt entreprises publiques lanceront dès cette année leurs offres publiques de vente et deux importantes compagnies privées devraient annoncer leur entrée en bourse.
D'autres changements, sont attendus par un autre segment du secteur financier, à savoir le crédit immobilier. Ce dispositif, lancé en 1998, vise à offrir la possibilité à certaines catégories sociales d'accéder au crédit bancaire pour l'obtention d'un logement, et aux promoteurs de financer leurs projets immobiliers. Cette initiative n'a cependant pas rencontré le succès escompté. En cause, le faible pouvoir d'achat, mais surtout les forts taux d'intérêts (11%) qui étaient pratiqués lors du lancement de ce produit. Pour certains analystes, c'est aussi le lancement par l'Etat du dispositif de location-vente, permettant aux acquéreurs le payement facilité de leur logement sur vingt ans, avec zéro intérêt qui a eu des retombées négatives sur ce produit. " En terme de location-vente, les premières projections du gouvernement tournent autour de 100.000 logements, or le déficit en logements tourne autour de 700.000 à 800.000 logements. Aussi, la location-vente cible une certaine population qui n'est pas la notre. Le logement promotionnel est destiné à des personnes qui ont plus ou moins de revenus. Notre gamme a l'avantage de tendre vers un produit de qualité supérieure", affirme le P.D.G. de la Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI), Mr. Mourad Goumiri. " Notre stratégie est donc de pouvoir assurer le développement de ce marché, de créer un partenariat avec toutes les entreprises qui souhaitent le faire et ensuite de mettre en place la privatisation de cette entreprise le plus vite possible. Pour cela, il nous faut un partenaire international qui soit du métier, afin que nous puissions profiter des technologies nouvelles, de son expérience". En attendant, la SGCI développe un cycle de formation avec le PNUD. " Nous allons prochainement signer un contrat avec la Banque Mondiale de plusieurs millions de dollars pour développer ce marché, en terme de formation, de procédures, d'études et de moyens logistiques ". C'est un peu pour cela que la SGCI qui " cherche à mettre en place les mécanismes qui puissent débloquer tous les verrous qui gênent l'épanouissement du secteur de l'habitat, notamment les problèmes juridiques, techniques, économiques et les études d'évaluation ", aux dires de Mr. Goumiri qui prévient aussi: " Non seulement il faut venir investir mais il faut faire vite, car en terme de garanties, nous avons des réserves de change relativement importante, nos comptes nationaux sont relativement bons ; nous sommes un risque acceptable".
PRIVATISATION
Un signal fort destiné aux investisseurs
Après sa rupture avec plusieurs années de politique dirigiste, l'Algérie a choisi l'option du libéralisme contrôlé afin d'évoluer de façon plus compétitive, dans un marché globalisé. Dans le vaste chantier de réformes qui l'attend, le gouvernement de Mr. Benflis se fixe des priorités. La première d'entre elles, est de renforcer le rôle du secteur privé et de garantir un environnement macro-économique favorable à son développement. Un cadre réglementaire plus souple a donc été mis en place, notamment afin d'attirer les investissements, tant nationaux qu'étrangers. Dans le même temps, un programme de privatisation des entreprises publiques a été lancé avec différents degrés de succès.
Un cadre réglementaire favorable à l'investissement
Sur le plan législatif, la liberté d'investir a été consacrée par le code des investissements de 1994, qui a accordé les garanties nécessaires et prévu des avantages substantiels pour les investisseurs privés. Cette phase a été suivie par une période d'assainissement de 1996 à 1998. D'autre part, deux textes majeurs ont été adoptés par le Parlement en août 2001. Il s'agit de la loi relative au développement de l'investissement et celle concernant la privatisation et à la gestion du secteur public. Ces mesures se traduisent par une baisse significative des taxes, des redevances fiscales et des charges sociales. Un assouplissement des procédures administratives, ainsi que l'octroi de différents avantages sont également d'application. Nourredine Boukrouh, ministre du commerce, anciennement en charge de la participation et de la coordination des réformes, confirme: " Ces dernières années, l'Algérie a réalisé d'importantes avancées avec l'ouverture de son marché aux échanges internationaux et aux investissements directs étrangers. Il fallait donc que les lois puissent offrir plus de flexibilité à la prise de participation dans le capital des entreprises publiques et, surtout, donner davantage d'opportunités pour le développement des investissements directs étrangers ". Tous ces incitants procurent à l'Algérie un régime fiscal extrêmement attractif.
Le gouvernement manifeste donc une volonté d'adapter la fiscalité au nouvel environnement économique et social du pays, mais aussi au processus de globalisation qui imposera à terme une uniformisation des législations et des procédés. Cette réforme de l'outil fiscal, dont la finalisation est prévue à l'horizon 2005, s'avérait être indispensable pour assurer davantage de transparence et lutter efficacement contre le marché informel, la fraude et l'évasion fiscale. Alors qu'auparavant, le gouvernement comptait majoritairement sur la fiscalité pétrolière, il préfère maintenant se tourner vers un système de taxation plus ordinaire et moins dépendant des fluctuations du cours du baril. De nouvelles règles fiscales ont donc été introduites dans la loi de finances, notamment celles concernant les sociétés. Actuellement, la fiscalité ordinaire contribue à hauteur de 40 % au budget de fonctionnement et d'équipement contre 60 % pour la fiscalité pétrolière.
En matière d'investissement, les opérateurs économiques peuvent bénéficier d'avantages significatifs, grâce à des taux d'imposition réduits. Mais malgré la création d'une Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI), destinée justement à faciliter l'application des procédures fiscales, la lourdeur administrative rebute encore bon nombre d'entrepreneurs qui doivent se confronter à de nombreux obstacles, tel celui de la difficulté de rapatriement de leurs gains. Un guichet unique décentralisé a, par ailleurs, été mis en place. Il est déjà opérationnel à Alger et dans quatre autres départements. Il sera, à court terme, présent sur l'ensemble du pays.Cette initiative a été appuyée par la création d'un fonds d'appui aux investissements, qui prendra en charge les dépenses relatives aux infrastructures extérieures, à l'image des routes, de l'électrification ou de l'alimentation en gaz et en eau. Il n'empêche, et il faut le répéter,que malgré ces effort pour clarifier et simplifier les procédures administratives, de grosses lacunes subsistent et pénalisent l'investissement. Ainsi, par exemple, en matière de foncier industriel, il est fort préjudiciable qu'un investisseur, qu'il soit national ou étranger, rencontre d'énormes difficultés à acquérir la moindre parcelle de terrain.
ANDI et CPE
Afin de jouer à la fois le rôle de guichet unique et gérer le fonds de soutien à l'investissement, le gouvernement a mis en place une Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI). Son directeur général, Madjid Baghdadli, en explique les deux missions stratégiques: " La première est une mission d'information et d'accompagnement du promoteur. L'information par l'accueil, la compréhension du projet, l'offre d'information, la mise à disposition de banques de données (…). Pour l'accompagnement, la mise à disposition d'un guichet unique permet au promoteur de réaliser sur place, la majorité de ses documents. La deuxième mission importante qui revient à l'ANDI relève de son caractère d'agence d'Etat. Ainsi, c'est nous qui délivrons l'attestation d'éligibilité aux avantages. " L'ANDI accorde donc les avantages et les exonérations fiscales sur des périodes pouvant aller jusqu'à dix ans. A charge également pour cette structure de faciliter les démarches administratives et l'obtention d'assiettes foncières, étant donné qu'elle a la possibilité de mettre en relation l'investisseur avec les autres administrations (impôts, douanes, collectivités locales.) dans le cadre du guichet unique. Celui-ci vise à une simplification des procédures, ainsi qu'à la lutte contre l'immobilisme administratif et la pesanteur bureaucratique, encore trop présents.
Placé sous l'Autorité et la Présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil de Participation de l'Etat (CPE) est l'organe suprême définissant la politique nationale concernant les Entreprises Publiques Economiques (EPE), qu'il s'agisse de leur politique générale dans le cadre du secteur public ou de leur privatisation. Ce Conseil est constitué par l'ensemble des ministères économiques et est en mesure de prendre des décisions dans des délais plus rapides, lorsque les circonstances le nécessitent. A titre d'exemple, Mr.Boukrouh explique: " Lorsque nous avons signé, en juin dernier, un partenariat avec le groupe indien Ispat-LNM dans le cadre d'une collaboration avec le complexe sidérurgique Sider, le partenaire a demandé des avantages supplémentaires liés au coût de l'énergie. Cette requête allait au-delà de ce que prévoyaient les anciens textes (…) Mais étant donné l'importance de ce complexe qui n'emploie pas moins de 13.000 personnes et produit 800.000 tonnes/an, le gouvernement a décidé de répondre favorablement à cette demande".

Dissolution des anciens holdings d'Etat
En ce qui concerne la privatisation des entreprises publiques, une nette réduction du nombre d'intervenants est venue en assouplir les procédures d'acquisitions. Les nouveaux textes traduisent, quant à eux, une profonde révolution des mentalités. " Au début, lorsque l'Algérie a commencé ses réformes pour passer d'une économie dirigée à une économie de marché, les mentalités n'étaient pas préparées à accepter tout de suite la notion de privatisation, parce qu'elle était perçue négativement (…) La législation qui avait été introduite dans notre pays en 1995 tenait compte de cette réticence mentale, économique et politique. Mais depuis, les Algériens ont évolué en même temps que l'économie de marché", explique Mr.Boukrouh. La nouvelle ordonnance d'août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques stipule, entre autres, que tous les secteurs d'activités économiques, autrefois publiques, sont maintenant éligibles à la privatisation. La puissante Sonatrach, longtemps considérée comme chasse-gardée par les autorités algérienne, est elle-même soumise à certaines restructurations, notamment via des opérations de joint-ventures avec des entreprises pétrolières internationales.
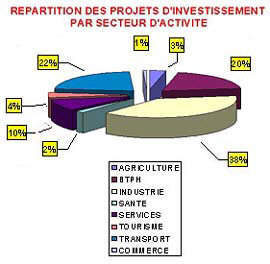
La loi d'août 2001 consacre aussi la dissolution des onze anciens holdings d'Etat. Ces holdings géraient environs 1.400 entreprises à travers le pays. Ils sont maintenant remplacés par un système d'organisation et de fonctionnement simplifié, qui regroupe les entreprises par secteurs d'activités. 28 Sociétés de Gestion de Participation (SGP) se mettent progressivement en place. Ces sociétés ne sont pas des organes de gestion, ni de développement de l'activité ; elles ont pour mission de préparer les entreprises placées sous leurs tutelles à la privatisation et au partenariat. Il n'est donc pas question, comme c'était antérieurement le cas, d'ingérence dans les prises de décisions opérées par les différentes entreprises. Le processus de privatisation s'appliquera selon quatre formules préétablies ; l'appel d'offre national et international, le gré à gré, l'introduction en bourse ou encore la cession au profit des travailleurs.
Soutien des instances internationales
Dans sa tâche, le ministère de la Participation, grand orchestrateur du processus de privatisation, s'attache les services de grandes instances internationales. Ainsi l'affirme Mr. Boukrouh: " comme nous sommes nouveaux dans la mécanique des privatisations, les pouvoirs publics ont voulu s'attacher les services de la Banque Mondiale pour les accompagner par l'expertise et le conseil (…). La présence de la Banque Mondiale est une garantie pour l'opinion internationale ainsi que pour les milieux d'affaires ; elle atteste que les privatisations se déroulent dans la transparence ".
Ce désengagement du gouvernement de la plupart des secteurs dont il avait la charge, ne doit cependant pas être compris comme un abandon de l'économie algérienne à un capitalisme sauvage. L'Etat continuera d'assurer sa fonction de régulateur et de garantir le maintien des besoins sociaux élémentaires. Le programme qui vise à solutionner la crise du logement auquel fait actuellement face l'Algérie en est la première preuve. Le fait est qu'après de trop nombreuses années d'un dirigisme néfaste au développement d'une économie de marché, la privatisation est perçue comme un outil de relance. Elle devrait participer à la diversification de l'activité économique et réduire ainsi la trop grande dépendance du pays envers son pétrole. Ce processus de privatisation reste cependant très influencé par les priorités gouvernementales; à savoir privilégier le développement économique à moyen terme des secteurs de l'industrie et des services, avec en trame de fond, la préservation de l'emploi.
INDUSTRIE
Vers de nouveaux horizons
Depuis le début des années 90, l'industrie algérienne, à l'image de tous les secteurs de l'économie nationale, s'est engagée dans un processus de réformes principalement articulées autour d'opérations de restructuration des entreprises publiques qui représentent 80 % du potentiel industriel du pays ; les 20 % restants constituent un tissu de PMI-PME privées. Ces entreprises peuvent jouir de facteurs prépondérants pour développer leur compétitivité, tels des coûts de production avantageux et un marché en pleine croissance.
Hors hydrocarbures, qui représente 97% des exportations, le secteur industriel manufacturier couvre un large panel d'activités, avec notamment l'industrie de base (métallurgie, sidérurgie, mécanique), la filière textiles et cuirs, l'industrie électrique et électronique, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la chimie, etc. L'essor de tous ces secteurs dépendra, pour partie, de la bonne gestion des pouvoirs publics dans la mise en œuvre du plan de relance, notamment à travers une politique de restructuration fondée sur la privatisation.
Grands axes de la nouvelle politique industrielle
Les objectifs assignés au secteur industriel doivent, avant tout, prendre en considération les perspectives de son développement et de sa compétitivité dans le nouveau contexte d'ouverture du marché. La prochaine adhésion de l'Algérie à l'Organisation Mondiale du Commerce et l'accord d'association avec l'Union Européenne constituant évidemment un incitant majeur pour la mise à niveau de l'outil de production. Si des efforts notoires ont déjà été accompli, beaucoup de chemin reste à parcourir en terme de performances et de compétitivité. Le développement du secteur industriel continue , trop souvent, d'être tributaire de nombreuses contraintes: équilibre financier fragile, investissement trop réduit, environnement institutionnel et financier peu performant, vétusté des équipements et absence d'ouverture sur les techniques modernes de gestion.
Il apparaissait donc urgent d'impulser une nouvelle dynamique de restructuration qui définisse les conditions et les besoins de la mise à niveau du secteur industriel, tant dans son fonctionnement interne que par rapport à son environnement. Cette exigence passe par un désengagement de l'Etat de la gestion des entreprises, pour désormais se limiter à des mesures d'encouragements, à travers une politique industrielle dynamique. " Il est entendu que l'objectif principal de tout ce processus reste le renforcement de l'autonomie des entreprises dans la gestion. L'accompagnement des entreprises par l'Etat, dans l'étape actuelle, vise la préparation de celles-ci à la privatisation, pour garantir à l'Algérie un secteur privé, qui pourrait jouer un rôle primordial dans la création d'emploi et dans l'établissement d'une croissance durable.Ceci permettra à l'Etat de se retirer, progressivement,de la sphère de production. ", remarque Mr. Abdelmadjid Menasra, ancien ministre de l'industrie et de la restructuration.
Quittant son ancien rôle de régulateur d'une économie planifiée, l'Etat à donc maintenant la tâche de sensibiliser les entreprises aux lois de la concurrence. Un programme d'appui au développement de la compétitivité industrielle a été élaboré en ce sens. Les priorités retenues concernent, notamment, le soutient des entreprises dans leurs démarches de modernisation et d'investissement, par une politique de restructuration privilégiant des ajustements qualitatifs, le partenariat et les privatisations. Des services d'appui à l'industrie (ingénierie, formation spécialisée, recherche et développement, contrôle de qualité, etc.) ont, par ailleurs, été mis en place.
L'apport du partenariat
L'action de partenariat est une action déterminante pour élargir la base industrielle et amener les entreprises à conforter leurs positions vis à vis du marché national, mais aussi et surtout des marchés extérieurs. Parlant des entreprises publiques, Mr. Menasra confirme d'ailleurs: " (…) la seule solution est la recherche de partenaires qui obtiendront un marché important, en contre partie de leurs apports en fond, en technologies et en expertises. C'est là, la seule issue pour ces entreprises qui feront l'objet d'un traitement particulier de la part de l'Etat à travers un assainissement financier, une réorganisation et une refonte de leurs structures ".
La sidérurgie, l'une des branches les plus importantes de l'industrie nationale, est résolument engagée dans ce processus de partenariat. L'exemple du complexe Sider d'El Hadjar (Est Algérien) est éloquent à ce sujet.
" Nous avons réussi à trouver un partenaire stratégique au terme de négociations ardues, qui ont donné lieu à un accord avec Ispat International. Il s'agit d'un partenariat réussi, qui a drainé des investissements pour le renouvellement de l'outil de production. C'est également un partenaire qui va augmenter le volume et les capacités de production et permettre une recherche de marchés pour exporter l'excédent. " Explique Mr. Shrider Marar, P.D.G. de ISPAT Annaba qui estime aussi que la venue de son groupe en Algérie a été motivée par les nombreuses opportunités offertes par le pays, d'abord à cause de l'existence d'un marché intérieur, ensuite en raison du grand avantage que représente la proximité du Maroc et de la Tunisie. Le partenariat Ispat - Sider devrait assurer un chiffre d'affaires minimal de 300 millions de dollars et assurer le maintient de 12.000 emplois ; une hausse de production de 30% est, par ailleurs, déjà atteinte. Au-delà des avantages offerts par le site lui-même, dont l'existence d'un port et la proximité de la rive sud de l'Europe, Mr. Marar remarque que son groupe a reçu tout le soutien nécessaire de la part du gouvernement.
Dans un segment connexe, l'ENCC, est un des rares équipementiers national opérant dans la chaudronnerie et la mécanique. Ses produits son généralement fabriqués sur mesure et sont destinés à l'équipement des infrastructures, ainsi qu'à celui de l'industrie. L'entreprise collabore avec différents secteurs, tels celui des matériaux de construction, de l'hydraulique ou encore de l'énergie. Selon son directeur général, Mr. Karadja Medjoubi, l'ENCC cherche à accéder aux nouvelles technologies, mais aussi à améliorer ses ressources financières par la filialisation, c'est à dire partager les risques et augmenter ses parts de marché. L'ENCC a déjà fait l'expérience de partenariats, notamment via des opérations avec des sociétés asiatiques, telles JVC, Mitsubishi et CIETO.
Bati-or, une société évoluant dans le domaine de la construction, se tourne, elle aussi, vers le partenariat. " Nous avons discuté avec plusieurs partenaires afin de convenir d'une collaboration en vue de rentabiliser les systèmes de construction que nous possédons. Pour cela, nous recherchons un partenaire sérieux, afin de faire fructifier les capacités matérielles existantes au sein de notre entreprise. ", déclare Mr. Gana P.D.G. de Bati-or.
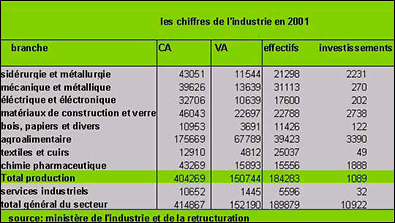
Une autre spécificité de cette société est l'utilisation de la sous-traitance. " La maîtrise du rendement et du délai est plus facile à mettre en œuvre par la sous-traitance, que par la gestion d'un effectif interne à l'entreprise. Cette manière de faire est, par ailleurs, liée avec la diminution des charges sociales et la satisfaction des partenaires et clients. " affirme Mr. Gana qui remarque, par la même occasion, que la sous-traitance permet davantage d'emplois indirects.
Mr. Zani, P.D.G. de l'entreprise de construction Ceralg regrette que ce type de gestion du personnel n'ait pas été appliqué plus tôt: " Nous aurions pu avoir la possibilité, avec les pays européens, de délocaliser certaines activités, très coûteuse du fait du prix de l'énergie et de la main-d'œuvre, et de les réaliser en Algérie. Ensuite, on réexporte une partie de la production et nous gardons l'autre pour notre propre développement. " Mr. Zani attend, par ailleurs, la privatisation totale de Ceralg avec impatience. " Il est impératif que nous puissions aller de l'avant et réussir cette privatisation. ", explique t'il. Ceci permettra sans doute à la société d'aller plus loin encore dans son partenariat avec Lafarge.
Un grand avenir pour la mécanique
Un autre pan de l'industrie qui connaît un essor remarquable, est celui des produits pharmaceutiques. Après quatre ans de libéralisation de ce secteur, l'Algérie a réussi à réduire sa facture d'importation de médicaments de près 500 millions de dollars/an. Ces performances encourageantes sont, notamment, dues à une restructuration du secteur pharmaceutique public, dont les missions ont été redéfinies ; entre autres, celle de la production. Cette nouvelle orientation a permis l'émergence d'importants groupes publics. Ces groupes développent par ailleurs, une série de joint-ventures avec des conglomérats internationaux tels que Pfizer, Novo Nordisk, Dar Dawa, Lilly, Rhône Poulenc ou encore Pierre Fabre. La stratégie des producteurs locaux cible les médicaments génériques et la substitution progressive des produits largement utilisés, comme ceux pour les maladies chroniques. On compte aujourd'hui une vingtaine de producteurs privés algériens, réunis majoritairement au sein du SAIP (syndicat algérien des industries pharmaceutiques) et une dizaine de groupes étrangers activant en Algérie.
Dans le secteur de la mécanique, la Société Nationale des Véhicules Industriels (SNVI) s'engage dans une voie de développement ambitieuse, après la réussite de son plan de restructuration et son retour à la croissance. Mr. Chahboub, P.D.G. de la SNVI, se positionne lui aussi en faveur du partenariat: " La SNVI, à travers des partenariats, cherche à s'entourer et à drainer des investissements en Algérie. " C'est le cas maintenant avec certaines activités définies, telle, par exemple, celle des boîtes de vitesses, pour lesquelles un partenariat est en cours avec l'Allemand ZF. La SNVI a, par ailleurs, entreprit des discussions avec de grands constructeurs automobiles, à l'image de Renault véhicules industriels, MAN ou encore Mercedes. Il se tourne également vers les marchés extérieurs et notamment ceux des pays arabes et l'Afrique francophone. Il reste que le secteur de la mécanique en Algérie est prometteur, avec une demande qui va sensiblement croître dans les prochaines années, plus encore si la relance économique annoncée se met en place.
Objectif exportation
GIPEC, leader national de l'industrie papetière. Cette société, jouissant d'une bonne santé financière, affiche clairement ses ambitions par la voix de son P.D.G., Mr. Mustapha Merzouk: " Nous avons comme axe de travail stratégique l'ouverture de notre groupe à un partenariat multiforme, national ou étranger, susceptible de déboucher sur la privatisation totale ou partielle de nos filiales ". D'autre part, Mr. Merzouk signale que c'est le partenariat qui permettra à son groupe de se moderniser et d'améliorer son niveau de production pour la pénétration de nouveaux marchés. L'exportation est, en effet, elle aussi, un axe prioritaire du développement de GIPEC. " Nous ciblons actuellement le marché maghrébin et nous somme en train de réaliser une petite percée sur le Moyen-Orient. D'ici peu, je pense que nos produits seront prêts pour l'exportation sur les marchés européens et asiatiques ", affirme Mustapha Merzouk.
Cette volonté de s'aligner sur un esprit de compétitivité et d'ouverture est également perceptible dans les propos de Mr. Belhadj Mokhtar, P.D.G. de Belcol, une compagnie privée jouissant d'une longue tradition dans le domaine de la confection de colles industrielles et qui est aujourd'hui, le leader algérien de ce marché, avec 60% des parts. " Il est vrai que nous somme leader sur le marché local, mais nous recherchons encore à acquérir de l'expérience et du savoir-faire. Notre technique est certes bien au point, mais reste cependant perfectible. Il nous reste encore quelques lacunes ; nous comptons à la fois sur nous-mêmes et sur notre partenaire pour arriver à les combler. Notre partenaire aura le savoir-faire et les techniques, nous avons de notre côté une main d'œuvre compétente, composée de techniciens formés grâce à des stages à l'étranger, ainsi qu'une implantation de premier choix sur le marché algérien ". L'objectif de Mr.Belhadj Mokhtar est de pénétrer le plus de marchés possible, afin d'exporter au moins 25% de la production. Aujourd'hui, l'exportation de Belcol ne représente que 5% du chiffre d'affaire.
Un autre pan de l'économie appelé à un essor prochain est certainement celui des matériaux de construction. On note, en effet, une augmentation constante de la demande des algériens en ciment. Actuellement, la consommation annuelle tourne autour de 8.5 millions de tonnes. Dans cinq années, cette consommation avoisinera vraisemblablement les 12 à 13 millions de tonnes/an. Les cimenteries, toutes détenues par l'Etat, seront-elles aussi amenées, dans les deux années à venir, à connaître un programme de réhabilitation et de privatisation (trois d'entre elles font déjà l'objet d'un appel d'offre). Cette opération sera accompagnée par un encouragement à de nouveaux investissements privés. La question du respect de l'environnement sera, quant à elle, bien évidemment prise en considération.
L'industrie algérienne retrouve progressivement un nouveau souffle. Stimulée par une nouvelle génération de patrons ambitieux, elle s'engage sur la voie d'un libéralisme adapté, résolument tourné vers le monde extérieur. Forte de ses atouts, tels la proximité du vaste marché européen et des coûts de production avantageux, l'Algérie offre aux opérateurs économiques un vaste terrain d'investissements. Ces derniers sont soutenus dans leurs efforts par un gouvernement entièrement acquis à leur cause. Mr. Abdelmadjid Menasra rappelle ainsi que " La loi algérienne ne fait pas de distinction entre les investisseurs nationaux et étrangers. Le gouvernement favorisera toujours et davantage les formalités ayant trait à la réalisation de l'investissement. " L'ancien ministre confirme également que le marché algérien est porteur, avec une base industrielle solide, une main d'œuvre qualifiée, de l'énergie à bon marché et d'excellentes opportunités d'affaires.
LE SECTEUR PRIVE
Moteur de l'économie algérienne

L'importance du secteur privé en Algérie est souvent méconnue. Cette perception inexacte trouve, sans doute, son origine dans les relations commerciales qui ont prévalu, des décennies durant, entre des agents économiques étrangers et les entreprises publiques algériennes. Depuis 1998, le secteur privé a dépassé le secteur public et participe activement au changement des mentalités, dans le cadre d'une professionnalisation de l'économie. Il représente actuellement 60 % de la valeur ajoutée, hors hydrocarbures et emploie davantage de travailleurs que le secteur public. Le privé constitue, par ailleurs, le moteur essentiel de tout développement économique et social. Il s'impose donc au profit du public et démontre ainsi que toute relance de l'économie algérienne, passera nécessairement par sa réhabilitation. Au regard de ce marché relativement vierge, les opportunités d'investissements ne manquent pas, les opérateurs économiques ne s'y trompent pas et les projets foisonnent.
La voix du patronat
Interlocuteur maintenant incontournable pour le gouvernement, le secteur privé s'organise autour d'associations patronales, à travers lesquelles il compte exprimer sa vision des réformes pour le développement économique. On compte aujourd'hui de nombreuses organisations patronales, dont le FCE, la CIPA, la CGEOA, l'association SEVE, qui est l'organisation des femmes chefs d'entreprises, et la toute récente association des jeunes dirigeants. Le patronat siège aussi au Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque Centrale algérienne et à l'ANDI depuis le début de cette année.
L'une des organisations les plus en vue est le Forum des Chefs d'Entreprises, totalisant 83 adhérents, en grande partie des industriels, pour un chiffre d'affaires global de 220 milliards de dinars. Son président, Mr.Omar Ramdane, en explique l'utilité: " L'objectif de ce forum est la création d'une organisation légère et facile, où les entreprises peuvent avoir un espace pour réfléchir aux questions économiques, analyser des thèmes qui concernent les conjonctures et formuler des solutions d'abord à l'attention des pouvoirs publics, pour aider à la prise de décision. Par la suite, nous voulons développer un certain nombre de services au bénéfice de l'entreprise ". Le rôle principal du forum est donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics par des contributions et des propositions concrètes, afin que les choses aillent plus vite. Il s'agit d'obtenir une oreille plus attentive de la part du gouvernement et être consulté dans les grandes décisions, notamment dans celles concernant les enjeux de l'accord d'association avec l'Union européenne et la préparation de l'adhésion à l'OMC. L'un de ces enjeux majeurs est bien entendu relatif à la suppression des barrières douanières, ressentie comme une menace par le patronat qui demande un délai de préparation et de mise à niveau. En effet, en période de pénurie d'offre et sans réelles exigences de la part des consommateurs, certaines entreprises ont, dans le passé, obtenu des licences d'importation exceptionnelles. Evoluant autrefois dans un système fermé et jouissant, de ce fait, d'un protectionnisme primaire des taux de douanes, les sociétés algériennes ont donc parfois des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles de la libre concurrence.
L'explosion du privé
L'avènement du secteur privé algérien est relativement récent. Dans les années 60 - 70, une base industrielle puissante avait été créée, financée par les recettes pétrolières, l'endettement externe et la création monétaire ; c'était l'époque de l'Etat providence.

C'est seulement en 1982 que le gouvernement accorde au secteur privé un rôle complémentaire à celui du secteur public, dans des activités connexes à la transformation et à la distribution. Le secteur privé n'est cependant pas autorisé à investir plus de 35 millions de francs. En 1993, toutes les activités sont ouvertes au secteur privé, sans plafond d'investissement. Mais cette liberté toute nouvelle coïncide avec une crise de liquidités sans précédent. Enfin, dès 1995, l'entrepreneur privé dispose enfin de tous les instruments de gestion de sa société, et le secteur peut dès lors prendre son essor.
L'emblème de la réussite du secteur privé algérien est, très certainement, le groupe Khalifa qui connaît, depuis quelques années, une expansion fulgurante. Son secrétaire général, Mr. Rachid Amrouche, résume le positionnement et les ambitions du groupe: " En termes de stratégie, nous suivons une politique de croissance interne. Ainsi, avec le mouvement de libéralisation de l'économie algérienne qui encourage l'initiative privée, nous avons commencé par constituer et étendre notre réseau commercial afin de toucher l'ensemble des franges de la société.
Ceci aussi pour asseoir notre position et détenir des parts de marché conséquentes. Ce processus est en voie d'approfondissement et se trouve agrémenté depuis peu par une politique de croissance externe, qui nous a permis de nous rendre acquéreur d'un certain nombre d'entreprises ; telles la compagnie aérienne Antinéa Airlines en Algérie, un établissement bancaire en Allemagne, la Erste Rosenheimer Privatbank, et dernièrement, toujours en Allemagne, Philipp Holzmann International. " C'est, entre autre, grâce à cette stratégie d'expansion que le groupe Khalifa est arrivé à s'imposer. En regard des accords commerciaux auxquels l'Algérie compte ou a adhéré, le groupe aspire, par ailleurs, à jouer un rôle de premier ordre dans le cadre de la réalisation de partenariats.
En marge de l'exceptionnelle réussite du groupe Khalifa, de nombreux entrepreneurs marquent, par leur dynamisme, leur volonté de, non seulement, faire évoluer leurs compagnies, mais aussi de participer à l'évolution de l'Algérie.

Tel est le cas, dans le secteur agroalimentaire, de la Nouvelle Conserverie Algérienne (NCA), qui assure principalement le conditionnement et la vente de fruits et légumes. Mr. Slim Othmani, directeur général de cette entreprise familiale, est très élogieux envers les nouvelles réformes entreprises par son pays: " L'impact des réformes libérales est extrêmement positif, parce qu'elles nous ont permis de diversifier nos sources d'approvisionnements de stimuler la compétition (…) qui dit compétition, dit croissance".Toujours optimiste et confiant dans l'immense potentiel de la jeunesse algérienne, le directeur général de NCA remarque une évolution dans les mentalités entrepreneuriales: " Il y a un changement d'attitude culturel dans la perception de l'outil de production ; et ce changement d'attitude n'est pas concentré uniquement au niveau managerial, mais il est communiqué jusqu'à la base de l'entreprise. " Mr. Othmani note, d'autre part, la volonté gouvernementale à encourager l'agriculture et s'attend à voir, à très court terme, des excédents agricoles en Algérie.
" Il faut forcément qu'il y ait un travail de rapprochement entre le secteur de l'agriculture et celui de l'agroalimentaire et ce, afin que les cultivateurs comprennent quels types de produits nous pouvons transformer ou utiliser dans l'industrie agroalimentaire ".
Un autre exemple significatif de l'évolution observée dans le secteur de l'agroalimentaire est celui du groupe El Bousten, la plus grande conserverie de tomates d'Algérie, avec 35% des parts de marché. Au-delà du succès économique, la particularité de cette entreprise privée est son implication directe dans le développement du secteur agricole en y introduisant de nouvelles techniques, tels les engrais. C'est là une manière d'inculquer une certaine notion économique aux agriculteurs, qui limitent encore trop souvent leurs activités à une agriculture de base. Afin d'illustrer le succès de son groupe, Mr. Boudiaf, président d'El Bousten et dynamique représentant du nouvel esprit d'entreprise algérien, explique qu'" avant la création de l'usine en 1992, l'Algérie importait 25 à 30.000 tonnes de tomates par an, alors qu'actuellement la société produit un excédent de 20.000 tonnes destinées à l'export. "
Partenariats et perspectives d'exportations
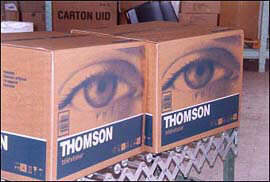
Toujours dans l'agroalimentaire, le groupe Mehri, qui détient la franchise pour la distribution du Pepsi-Cola sur le territoire algérien, est lui aussi illustratif du dynamisme du secteur privé. Djamel Mehri, P.D.G. de Pepsi-Algérie, partage son expérience du marché et affirme enthousiaste que " L'Algérie est l'Egypte des années 80 ", faisant allusion au boom économique que connaît actuellement le pays. Outre le partenariat avec Pepsi, la société est également liée avec Stella Artois pour la production des bières Tango, et avec Savola dans les huiles. Des négociations sont, par ailleurs, en cours pour étendre les activités du groupe au secteur hôtelier. Un autre créneau d'activité, celui de l'électronique, lui aussi été investi par le privé, connaît une croissance remarquée. Mr. Aït Yala, directeur général de BYA Electronic, explique ce succès notamment par la présence, en Algérie, d'une main d'œuvre qualifiée et bon marché, ainsi que par un coût énergétique raisonnable.
L'atout est donc de pourvoir développer des produits électroniques à moindre coût. Fort de leur collaboration réussie avec le groupe Thompson, les dirigeants de BYA Electronic insistent sur les avantages réciproques qu'offre le partenariat: " Nous avons un savoir-faire et une expérience qui sont démontrés tous les jours sur le terrain. Nous avons des managers de stature internationale et par conséquent, nous sommes ouvert à toutes négociations qui nous permettrons de progresser et d'aller de l'avant. "
Samy Boukaïla, vice-président de BKL, une société spécialisée dans la fabrication de châssis PVC, évoque les perspectives de son groupe. Comme pour beaucoup d'entreprises privées, la diversification de l'investissement est un thème récurrent. Déjà présente dans le domaine de la construction à travers une joint-venture avec une société canadienne, BKL veut aller plus loin. Samir Boukaïla voit son entreprise comme " un holding avec un nombre de filiales actives dans divers secteurs de l'économie, notamment celui du bâtiment, des télécoms et de la distribution. " Une issue parfaitement envisageable sur ce marché relativement vierge. Pour BKL, cette diversification de l'activité trouve aussi une explication dans la nécessité d'affermir sa position nationale et dans la volonté de conquérir davantage de marchés extérieurs. Déjà présent en Russie, au Moyen-Orient, en Irak ou encore en Libye, la préoccupation majeure de BKL est maintenant d'exporter vers les pays occidentaux, afin de démontrer son savoir-faire.
Le dynamisme des PME et PMI
Ce nouvel esprit d'entreprise n'existe pas seulement dans les grandes entreprises, il est également perceptible au sein des PMI et PME, qui prolifèrent partout dans le pays. Le CEIMI, l'organisation des entrepreneurs de la région de la Mitidja (centre du pays), forte de ses 362 adhérents, travaille en collaboration avec les ministères de l'Industrie, du Commerce et celui des Finances et avec plusieurs associations, étrangères également, pour établir des rapprochements profitables entre les hommes d'affaires. Cette organisation est le porte-voix de l'une des plus importantes régions économiques du pays, notamment au regard de son important tissu de petites et moyennes entreprises. Elle veille à établir des contacts et à assurer la promotion de ces sociétés. " (…) le CEIMI développe une politique de collaboration et de concertation multidirectionnelle et multidimensionnelle, qui vise à impliquer directement et concrètement les entreprises et les industriels que nous représentons dans tout ce qui touche au développement de la vie économique de la région", souligne Mr. Safar Zitoune, secrétaire général du CEIMI.
Cette démarche pro-active, nous la retrouvons dans de nombreuses PMI ou PME algérienne, à l'image de la Simap. Le chiffre d'affaires de cette entreprise productrice d'articles scolaires connaît une évolution remarquable depuis une petite dizaine d'années. Ces bonnes performances lui ont valu l'opportunité de pouvoir jouir d'un programme de mise à niveau initié par le ministère de l'industrie, en collaboration avec le PNUD. Avec plus de 50% des parts de marché, Mme Belbachir, P.D.G. de la Simap, est fière des performances de son entreprise. Conquérir des parts de marché à l'extérieur n'est pas encore à l'ordre du jour, mais Mme Belbachir n'exclu pas l'option d'un partenariat: " Je souhaiterais trouver un partenaire pour son savoir-faire et une maîtrise totale de la gestion et de l'outil de production. (…) Là, la conquête de marchés extérieurs aura un sens et une durée, celle du marché national une assisse très forte. "
Beaucoup considère que la résurgence du secteur privé algérien est la seule issue, pour une réelle modernisation et un développement durable de l'économie du pays. Il reste, toutefois, à affirmer davantage ce secteur qui souffre encore de nombreuses incohérences, notamment celles dues à une bureaucratie trop pesante. Les résultats enregistrés jusqu'ici par le privé restent fragiles ; les entreprises doivent à tout prix maintenir leurs efforts de modernisation, ainsi que leur politique d'ouverture et d'investissement. Elles doivent être soutenues dans cette tâche par une législation adaptée et rapidement effective.
Malgré certains déboires, l'économie algérienne s'est sensiblement améliorée en quinze années de libéralisation. Il s'agit maintenant de poursuivre scrupuleusement le programme de réformes, en attribuant une importance prépondérante au développement du secteur privé. Le défi majeur à relever est l'accession à un taux de croissance élevé qui permettrai une progressive résorption du chômage. Pour répondre à ce défi, il faut, entre autres, établir une stabilité macro-économique, réunir des ressources financières suffisantes, mais surtout confirmer des réformes micro-économiques, destinées aux entreprises. Ces mesures doivent développer la performance et la compétitivité des entreprises, combattre le recours systématique à l'importation, en stimulant l'offre nationale, et promouvoir l'exportation de produits manufacturer.
ENERGIE ET MINES
La locomotive des réformes
La vague d'ouverture qui caractérise l'ensemble des secteurs est encore plus marquée dans celui de l'Energie, qui reste le champ dominant de l'économie du pays. Le développement de ce secteur et de celui des mines est un impératif pour la stabilité financière de l'Etat, la viabilité des finances extérieures et la croissance de l'emploi. Ce développement n'est plus envisageable sur la seule base de capitaux publics. Il est indispensable d'associer des capitaux privés, locaux et étrangers, à la mise en valeur du formidable potentiel de développement que représente ce secteur.
Les priorités de la nouvelle politique énergétique et minière sont de plusieurs ordres. Il s'agit notamment d'encourager la création de PMI et PME autour des différents pôles d'activités du secteur ; d'améliorer, par le biais de la concurrence, l'organisation managériale, la qualité et les coûts de production; d'exploiter les opportunités offertes par la globalisation, pour les investissements à l'intérieur (exportation d'électricité, valorisation des produits en aval du gaz et du pétrole, valorisation des produits miniers, etc.) et à l'extérieur.
Un nouveau statut pour la Sonatrach

In view of a more competitive market, algeria's energy sector, the most strategic sector of its economy, must be thoroughly prepared and organized to comply with the rules and regulations of world trade.
In the gas and oil sector, the first step is to abandon the reflexes of a centralized economy and set favorable rules and regulations for competition and free enterprise. "A bill was drafted clearly separating the functions of the state and companies. The function of the state is to govern economic and regulatory policies, whereas companies have a purely commercial role" explains Mr. Chakib Khelil, Minister of energy and mines and CEO of Sonatrach. Companies have thus the opportunity to operate in a free competitive market.
Sonatrach, the national oil and gas management company, will become, in this new legal framework, an operator like other operators, i.e. a purely commercial company, stripped of its former public powerhouse advantages. In the wake of this restructuring policy, Analft, a new agency, is about to see the day. Its duties will be to grant research and exploitation permits through calls for tender, to regulate the market and to collect company fees. However, Analft will mostly be in charge of promoting investment and guaranteeing access to the market with no discriminatory tariffs. In parallel to the reforms announced by the Ministry of Energy and Mines, companies of this sector will also be trained in the future system.
La Sonatrach, l'entreprise nationale de gestion du pétrole et du gaz, deviendra dans ce nouveau cadre légal, un opérateur, au même titre que les autres. C'est à dire une entreprise purement commerciale sans ses anciennes prérogatives de puissance publique. Dans le sillage de ces restructurations, une nouvelle agence, l'Analft, verra le jour. Son rôle consistera à accorder des permis de recherche et d'exploitation à travers les appels d'offres ; de réguler le marché et de percevoir les redevances dues par les compagnies. Mais l'Analft sera surtout chargée de promouvoir l'investissement et de garantir l'accès au marché sans tarifs discriminatoires.
Parallèlement, les réformes annoncées par le ministère de l'énergie et des mines seront accompagnées d'une formation des entreprises du secteur au futur contexte. La Sonatrach sera dotée d'un nouveau statut qui lui permettra de réaliser, sur un même pied d'égalité avec ses concurrents, des opérations commerciale. Ce processus sera accompagné d'une modernisation du management de l'entreprise et de l'acquisition de nouvelles technologies. A moyen terme, il s'agit aussi de préparer Sonatrach à l'ouverture de son capital." Notre ambition est de transformer la Sonatrach en une compagnie internationale qui soit leader dans la commercialisation du gaz dans la Méditerranée et le bassin atlantique. ", affirme le ministre Khelil qui souligne, en passant, le quasi-leadership dans la commercialisation du GPL et du condensa pour ces régions.

Les ambitions de la Sonatrach, douzième compagnie mondiale du secteur, ne s'arrêtent pas là ; un projet d'extension de ses activités est prévu au Pérou, la société compte, par ailleurs, renforcer sa présence sur le marché nord américain.
La mise en œuvre de cette stratégie d'expansion nécessite une politique de partenariat pour la conquête de nouvelles parts de marchés, mais aussi, dans une certaine mesure, pour un accroissement des performances de l'entreprise, afin de faire face à la concurrence.Cette mise à niveau est le leitmotiv des deux plus importantes filiales de la Sonatrach, Naftal et Naftec. Avec 80% des parts de marché dans la distribution, le stockage, le transport et la commercialisation des carburants, du GPL, des lubrifiants et des produits spéciaux, la Naftal se devait d'initier un processus de modernisation et de réhabilitation de ses infrastructures.
Cette exigence passe par l'assise des normes de sécurité industrielle et de protection de l'environnement, par la modernisation et l'extension de son réseau de stations-service, par le renouvellement de ses moyens de transport, ainsi que par l'augmentation de ses capacités de livraison par pipe. Pour sa part, la Naftec, leader national dans le raffinage des produits pétroliers, réalise de grands efforts pour la réduction des facteurs polluants provenant des carburants.
Dynamisme du secteur para-pétrolier
Spécialisée dans l'engineering et la construction d'installations nécessaires aux compagnies du secteur énergétique, GCB tente d'intégrer l'esprit de compétition. Libérée de la tutelle de la Sonatrach depuis 1983, cette entreprise à été initiée plus précocement à un mode de gestion autonome et s'apprête activement à faire face à davantage de concurrence. " nous avons commencé à nous y préparer, il y a plus de cinq ans, au niveau de notre personnel, avec le développement de la formation, mais aussi de la planification, de l'informatique, etc. Toutes ces mesures sont prises pour faire face à une concurrence plus importante, mais aussi afin de pouvoir gérer de nouveaux défis ", explique Mr. Akli Tarzalt, directeur général de GCB.

Dans le cadre de cette mise à niveau, le partenariat fait également partie des priorités de GCB, afin, notamment, de profiter d'un apport technique extérieur. " Maintenant que nous avons un certain savoir-faire dans le génie-civil, nous avons envisagé d'exporter nos services. Nous nous sommes d'abord orienté vers un voisin, la Libye, mais nous ne voulons pas faire cavalier seul. C'est pourquoi nous sommes à la recherche d'un partenaire qui puisse nous accompagner pour aller affronter la concurrence dans d'autres pays. (…) N'ayant pas la pratique de l'exportation, nous souhaitons démarrer avec une entreprise qui a l'expérience et le savoir-faire nécessaire. ", remarque Mr. Akli Tarzalt. L'esprit de partenariat et de diversification des activités anime également GCB en direction du marché local ; tel est le cas de l'intérêt particulier que porte l'entreprise sur le secteur du bâtiment.
" Il y a une crise terrible de logements à Alger; de ce fait, nous recherchons un partenaire qui puisse nous apporter une technologie, un procédé de construction, avec lequel nous pourrions construire des logements à moindre coût. " explique le directeur général de GCB. Mr. Hadibi, P.D.G. de BJSP, une société para-pétrolière opérant principalement dans la cimentation et la stimulation des puits, est très optimiste pour l'avenir de son secteur en Algérie. Cette entreprise s'est, elle aussi, libérée du giron de la Sonatrach dans les années 80, pour acquérir progressivement son indépendance par rapport à l'Etat. " La force de la BJSP réside principalement dans la maîtrise de ses coûts de production " explique Mr Rahibi. Mais cette force se trouve aussi dans la qualité de ses partenariats ; tels Ali Burton ou encore Schlumberger. Les objectifs de la BJSP sont, quant à eux, bien défini, ils ambitionnent le leadership sur les marchés de base de l'entreprise.
Sonelgaz vers la perte de son monopole
La filière des gaz industriels poursuit quant à elle son essor, avec des projets portés par des entreprises ambitieuses, telles qu'Hélios et Cogiz qui produisent et fournissent 70% de l'hélium du marché européen. En mai dernier, l'appel d'offre lancé par Cogiz pour la création d'une usine à Skikda a débouché sur une perspective de partenariat avec l'allemand Linde avec la possibilité de fournir de l'hélium sur 80% du marché européen. Une étude pour la construction d'une troisième usine en 2006-2007 est déjà en cours. Et les perspectives de croissance ne s'arrêtent pas à ce stade. Mr. Mahdad, P.D.G. de Cogiz, explique en effet: " notre ambition est de nous associer avec des partenaires qui ont un savoir-faire, afin qu'on puisse aller prospecter ensemble les marchés européens et se développer ailleurs que dans le domaine de l'hélium et de l'azote ".
Bien entendu, le secteur phare demeure le pétrole, là où les investissements se multiplient au rythme des contrats signés en association avec la Sonatrach. C'est sur ce terrain que les partenaires étrangers suivent avec une très grande attention les évolutions du marché, promis à une plus grande libéralisation. Comme le dit Mr. Ian McIntosch, directeur général pour l'Afrique du Nord de Petro-Canada, " l'une des choses que nous avons vu en arrivant ici, ce sont les promesses de changement. Nous attendons réellement la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui sera positive pour l'Algérie. Nous pensons qu'il y a là une opportunité de rendre l'Algérie plus attractive à l'investissement. Notre position est d'être constamment présent en Algérie, mais avec prudence en attendant les nouveaux changements ".
Quant à la nouvelle loi sur l'électricité, elle aura pour première conséquence la perte par Sonelgaz, la société nationale de l'électricité et du gaz, de son monopole. Cette grande entreprise publique sera transformée en une société qui pourra vendre ses actions aux investisseurs, offrant la possibilité à ces derniers de produire de l'électricité. Plusieurs entreprises internationales étudient de très près les opportunités de partenariats dans ce secteur de l'électricité, si elles ne se sont pas déjà engagées.
Récapitulatif des liens algéro-asiatiques
Si, depuis toujours, le partenariat a été très dense avec les pays européens et les Etats-Unis, la commercialisation des hydrocarbures et du gaz naturel de l'Algérie vers l'Asie subit l'handicape naturel de la géographie. En témoignent les exportations vers l'Asie qui n'ont jamais atteint la barre des 2 millions de tonnes par an. Cela n'empêche pas Sonatrach d'être présente en Asie, à travers sa filiale SPC-Asia (Sonatrach Petroleum Corporation Asia) qui exerce le trading à partir de Singapour. La SPC enregistre d'assez bons résultats, dans la mesure où elle commercialise pour une moyenne de 12 millions de tonnes/an, avec une marge bénéficiaire de 25 millions de dollars (1999).
La coopération avec l'Asie ne s'arrête pas là, à l'image du contrat signé par SPC avec Kawasaki Heavy Industries pour l'acquisition de deux nouveaux navires GPL, livrés en 2000. Précédemment, le partenariat avec la Malaisie avait fait un grand pas en avant, avec la signature, en décembre 1996, d'un contrat de recherche et d'exploitation au gisement El-Hidjara-Oued-El-Maraa, avec Petronas Carigali. Ce contrat traitait d'un financement de 38 millions de dollars pour une coopération s'étalant sur sept ans, comprenant le forage de quatre puits et la formation du personnel de la Sonatrach.
Les liens avec les compagnies asiatiques ont été approfondis progressivement ; la foire-exposition de Kuala Lampur de 1998, à laquelle avait pris part l'Algérie, donnait d'ailleurs un bel aperçu des intentions d'investissements de certaines d'entre elles en Algérie. Ainsi, en avril 2000, un accord portant sur l'amont pétrolier a été signé entre la Sonatrach et Petronas ; une série de projets ont, par ailleurs, été retenu pour des transformations en pétrochimie avec la raffinerie de Skikda. En juin de la même année, un contrat a été avalisé entre la Sonatrach et BHP (Australie), en association avec la firme américaine Petrofac et la japonaise JOOC, pour le développement et l'exploitation du gisement d'Ohanet (sud algérien). L'investissement est de l'ordre de 928 millions de dollars ; JOOC y contribue à 30%. Au menu de ce projet: une usine de gaz et une usine de carburant à réaliser, ainsi que 236 km de canalisations et 47 puits de développement, pour une durée d'exploitation de 8 ans.
Sur le marché algérien des services pétroliers, il y a lieu de noter la présence de la firme japonaise JGC, activant dans l'important gisement de Birkine qui offre une capacité de 300.000 barils/jours. Enfin, en mai 2001, l'Algérie a activement participé à la conférence internationale sur le GNL (gaz naturel liquéfié) de Séoul. En juin 2003, le pays espère pouvoir apporter sa contribution lors du congrès mondial du gaz à Tokyo. Il est vrai que certaines questions, dont celles relatives à l'environnement ou à la percée du GTL (gas to liquid), le nouveau carburant écologique, offriront certainement à l'Algérie de sérieuses opportunités d'échanges. Il convient également de souligner l'implication des banques asiatiques pour soutenir ces relations, à l'image des garanties de 50 et 80 millions de USD accordé respectivement par la Corean Exion Bank et la Japan Exion Bank qui marquent d'une volonté politique de raprochement, au même titre que la recente visite de la présidente indonesienne et du premier Ministre chinois en Algérie au mois de septembre dernier.
Intensification de la production minière
Avant l'indépendance (1962), l'activité minière en Algérie était orientée principalement vers l'exploitation des gisements de fer et de plomb - zinc. Un effort de prospection durant ces 30 dernières années a permis de développer l'infrastructure géologique de base et d'inventorier un grand nombre de sites, dont certains offrent de réelles perspectives d'investissement. Ainsi, en plus de l'exploitation de base (fer, sel, zinc, plomb, marbre, baryte, etc.), les recherches entreprises ces dernières années, ont permis de trouver des gisements d'or, de wolfram, d'étain, d'argent, de diamant, de mercure, de métaux rares et pierres précieuse et semi-précieuses.
Plus en avance dans le programme de libéralisation, le domaine minier est régi par une nouvelle loi approuvée en juin 2001. Elle permet, notamment, aux investisseurs privés d'exploiter les mines mises en concession et d'en commercialiser librement le produit. Instrument privilégié de ce secteur, l'Office de Recherche en Géologie Minière (ORGM) dispose d'une banque de données sur les mines, accessible aux investisseurs. Depuis la mise à disposition de ce service, trois appels d'offres pour la mise en concession de mines ont permis de lancer près de soixante dix projets d'exploitation, au nord du pays et dans les hauts plateaux. Dans le même temps, le ministère de l'Energie et des mines recherche des partenaires pour le traitement et l'exploration de l'or. Les gisements d'or devraient, en effet, connaître une exploitation plus continue. Cette tâche revient à l'entreprise nationale de l'or (Enor), qui a déjà réussi la première mise aux enchères de 60 kg de ce métal précieux en avril dernier. Des ventes similaires seront organisées périodiquement en Algérie. L'Enor a, par ailleurs, créé sa propre entreprise d'exploitation du gisement de Tirek au sud du pays, avec une capacité de 2000 tonnes/an. Un avis d'appel d'offres a aussi été lancé pour l'exploration du diamant et de l'or dans le sud-ouest de l'Algérie ; d'autres en appellent au partenariat pour l'exploitation du zinc et du plomb, ainsi que pour 50 petites mines de marbre, de pierres décoratives, d'agrégats, et de sel.
Activant dans la production du phosphate et du fer, Ferphos, aux dires de son Président directeur général, Mr. Mebarki, est l'exemple même de l'extraordinaire potentiel minier du pays ; " notre force est la possession d'un immense gisement de phosphate avec 2 milliards de tonnes de réserves. Notre gisement est le seul au monde à avoir une couche de 30 mètres de phosphate, l'un des plus réactifs au monde. (…) Nous avons les capacités d'extraire jusqu'à 4 millions de tonnes en phosphate brut ". En matière de partenariat, Mr. Mebarki révèle que l'association entre Ferphos et Ispat LNM a permis d'élever la production en fer à 240 millions de tonnes, principalement au profit du marché local. Avec de tels atouts, Ferphos a les moyens de ses ambitions, et non des moindres. " Nous comptons lancer très prochainement un premier projet de production d'acide phosphorique et de DAP en Algérie. Un deuxième projet vise à produire environ 150 milles tonnes de phosphate. Nous ciblons 750 milles tonnes par jour en matière d'acide phosphorique ", explique Mr. Mebarki qui en appel aussi à de nouveaux partenariats ; " Ce que nous recherchons en eux, c'est la technologie et un bon marché. Nous sommes ouverts à toutes propositions et discussions et sommes prêt à nous associer avec des partenaires étrangers, même au niveau du gisement. La nouvelle loi minière d'Algérie est un atout extraordinaire ".
L'objectif principal poursuivi est donc d'impulser un nouvel élan de développement au secteur minier afin qu'il contribue de manière significative à la relance de l'économie algérienne. Les perspectives de développement prennent donc principalement en considération la poursuite des efforts de modernisation de l'outil de production, l'intensification des recherches, ainsi que la recherche de partenaires étrangers détenteurs de capitaux, de technologies et de réseaux commerciaux pour le développement des activités minières.
Prise de conscience environnementale
La grande innovation apportée par le gouvernement en matière d'énergie, concerne la prise en charge de la question environnementale. Dans cette tâche, l'agence APRUE constitue l'instrument clé, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Dans ce secteur de pointe, le partenariat et le recours à l'expertise étrangère est un objectif stratégique. Donnant un aperçu du marché, Mr. Bouzeriba, directeur général de l'APRUE déclare: " nous orientons nos efforts vers les zones isolées, les zones où l'énergie conventionnelle n'est pas compétitive. Elle n'y est ni disponible, ni compétitive, parce qu'il faut la transporter sur de longues distances. Ces zones isolées, qui ne sont pas connectées, représentent autour de 4 à 5% du territoire national.(…) C'est donc toute cette partie du territoire qui devra être alimentée en énergie et, à première vue, l'énergie renouvelable pourrait constituer une alternative, parce qu'en termes d'investissements c'est beaucoup moins important mais cependant très rentable ".
Les restructurations que connaît le secteur énergétique sont capitales pour le développement et la croissance du pays. Outre l'exploration, un éléments décisif de cette croissance réside dans les projets de pipe line reliant l'Algérie à l'Italie (Enrico Mattei), à l'Espagne (Pedro Durran Farrecc) et à terme peut-être aux pays d'Afrique. Actuellement, on compte 11 pipe line gazier et 14 pour le pétrole sur une distance de 13.000 km. Dans ce marché en pleine expansion, l'Algérie bénéficie d'une situation géostratégique de choix, c'est ainsi que le pays développe de solide relations commerciales avec les pays d'Europe, les Etats-Unis et ses voisins du Maghreb. Pour le secteur minier, l'Etat entend toujours exercer son rôle de propriétaire du domaine, de promoteur de l'investissement et de régulateur de l'activité économique. En revanche, par l'adoption récente de lois, il entend se désengager des activités commerciales et accroître la contribution du capital privé à l'effort de développement du secteur.
TOURISME ET LOISIRS
L'atout du grand sud
En plus de l'exceptionnelle beauté et diversité de ses sites naturels, l'Algérie dispose d'un riche patrimoine culturel. Une manne touristique dont le pays n'a jamais su profiter pleinement. Les aléas de la politique, mais surtout le terrorisme de cette dernière décennie en ont décidé autrement. L'afflux d'étrangers se limite, pour l'instant, à une certaine classe d'hommes d'affaires. Mais le gouvernement compte profiter de l'ouverture de son marché et de l'amélioration de la situation sécuritaire, pour promouvoir une politique touristique ambitieuse et réfléchie.
Projet " horizon 2010 "
A charge du ministère du Tourisme de mettre en place le développement durable du tourisme en Algérie, à l'horizon 2010. Un projet a été élaboré à cet effet ; parmi ses objectifs, figure la valorisation du potentiel naturel et culturel, l'amélioration de la qualité des prestations de services, la réhabilitation d'une image positive de l'Algérie à l'étranger et la satisfaction des besoins des citoyens en matière de tourisme et de loisirs. Sans oublier bien sûr la contribution du secteur dans la résorption du chômage. Alors que les capacités d'accueil actuelles sont de l'ordre de 60.000 lits, le projet " horizon 2010 " ambitionne de doubler ce chiffre. Le volume des investissements privés devrait, quant à lui, être sensiblement augmenté. " L'Algérie est un pays totalement neutre, ayant vécu une crise assez difficile ; mais cette a fait que le pays s'est mis en marge du développement touristique pendant dix ans. Tout reste donc à réaliser. Il existe énormément d'opportunités d'investissements. " remarque Mr. Hammouche Belkacemi, directeur général de l' office national du tourisme (ONAT).
Pour ce qui est des produits touristiques, la nouvelle stratégie vise à produire des besoins adaptés à la demande interne et internationale. Sur ce point, la détermination de l'offre se fera sur la base de la situation touristique internationale et des perspectives de son évaluation. Il n'en demeure pas moins que le tourisme balnéaire, le plus demandé mondialement, est un atout privilégié. Le tourisme d'affaires est, lui, appelé à connaître un essor certain avec l'intensification des activités économiques et commerciales. L'exploitation des centres thermaux, qui connaît une demande interne considérable, représente à elle seule un immense atout commercial. Mais, la carte maîtresse du tourisme algérien réside très certainement dans les régions du grand sud, notamment le Hoggar et le Tassili. " Nous avons, à l'ONAT, mis sur le marché les produits du Hoggar et du Tassili, parce qu'ils ont une valeur et une richesse touristique incomparables ; c'est le seul produit qui dans l'Etat actuel des choses, sot susceptible de drainer une clientèle sur l'Algérie. (…) C'est avec ce produit, qui est un gisement extraordinaire, que nous voulons créer un effet de pompe, et reprendre progressivement les destinations phares de l'Algérie, comme à l'époque où elle était ouverte au tourisme. Ce sont les Oasis qui sont la partie centre-est du Sahara et la Saoura, au centre -ouest. ", explique le directeur général de l'ONAT.
Loisir: un marché méconnu
Le secteur des loisirs est, à l'image du tourisme, très peu exploité. Paradoxe pour un pays majoritairement peuplé majoritairement de jeunes, l'Algérie ne compte que très peu de théâtres, de cinémas, de centres culturel et sportif, de parc d'attraction ou de musés. Là aussi, un immense chantier se présente aux investisseurs. Mr. Louhibi, P.D.G. de Lazer Productions, une entreprise évoluant dans la production et la fabrication de supports musicaux, est l'un des rares entrepreneurs à investir dans ce marché.

Le succès de Lazer Productions est cependant révélateur des potentialités de ce créneau. " Notre chiffre d'affaires avoisine le million de dollars (2001) ; et nous distribuons actuellement les albums de Khaled, pour qui nous avons acheté les droits de la maison Universal (…) ", explique le president.
La nouvelle stratégie du développement touristique en Algérie, qui ambitionne de faire émerger une véritable industrie du tourisme, est dictée, outre l'importante manne financière qu'elle représente, par les enjeux socio-économiques du secteur et par les défis imposés au pays avec la globalisation. Cela nécessite, bien entendu, la coordination de l'effort de tous les secteurs car le tourisme est un secteur horizontal dont le développement dépend des autres secteurs tels celui des transports, de la culture, des loisirs de l'artisanat ou encore de l'environnement.
COMMERCE
Progressive intégration au marché global
L'Algérie est un pays qui dépend beaucoup de l'importation, avec près de 12 milliards de dollars US consacrés l'acquisition de biens de consommation, d'aliments, d'équipements industriels, de pièces détachées et d'intrants industriels. le secteur de l'exportation est lui essentiellement constitué par les produits pétrochimiques ; soit quelques 17,5 milliards de dollars US, ce qui représente 97% de l'export, 30% du PIB et 65% du budget de l'Etat. Les exportations hors hydrocarbures ne représentent que 3%, pour seulement 279 millions. L'agriculture reste marginale ; quant au secteur industriel hors pétrole, il stagne à 7% du PIB. Les principaux partenaires commerciaux de l'Algérie sont, tant à l'importation qu'à l'exportation, la France, les Etats-Unis, l'Italie.
Afin d'équilibrer la balance de ses exportations et d'attirer les investissements sur son sol, l'Algérie s'est maintenant résolument engagée dans une politique d'ouverture de son espace commercial, par l'adoption de différentes mesures. Parmi celles-ci on notera, un nouveau tarif douanier visant à simplifier les procédures tant à l'import qu'à l'export, ainsi qu'un soutien à l'investissement. Le pays a également souscrit à l'article VIII des statuts du FMI, consacrant la convertibilité du Dinar pour les transactions courantes. Mais la plus grande avancée illustrant la volonté d'intégration de l'Algérie au commerce mondial, réside dans les différents accords commerciaux ou de coopérations engagés avec l'Union européenne, l'OMC, l'UMA (Union du Maghreb Arabe), la Zone Arabe de Libre Echange ou encore, dans le cadre du NEPAD, qui devrait drainer l'investissement sur le continent Africain.
Mise en règle pour l'adhésion à l'O.M.C

Sur le plan du commerce international, l'Algérie a réalisé des efforts considérables afin d'optimiser ses chances d'adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce, notamment dans le cadre de la normalisation et de la propriété intellectuelle. Une première exigence a été de renoncer à une économie contrôlée afin de conformer l'économie nationale aux exigences de flexibilité, de concurrence et de sécurité, nécessaires pour entreprendre et investir librement. Au cours des deux dernières années, des textes législatifs et réglementaires ont, par ailleurs, été adopté en vue de libéraliser plusieurs pans de l'économie nationale. Dans ce cadre, la restructuration du secteur publique s'est concrétisée d'abord par la loi de 1995; ensuite par celle d'août 2001, qui prends notamment en compte une accélération du processus de privatisation. Conscient de son importance pour la croissance économique, le gouvernement a consacré une attention particulière à la promotion du secteur privé, notamment par l'adoption de textes de loi relatifs à la promotion de l'investissement et au système tarifaire.
Tous ces éléments doivent aller de paire avec une politique macro-économique assurant une stabilité durable. Sur ce point aussi, les progrès enregistrés par l'Algérie sont conséquents. Lourdement endettée, il y a cinq ans à peine, l'économie du pays présente maintenant des indicateurs encourageants, notamment grâce à un programme de stabilisation drastique et au soutien du FMI. La dette extérieure est en baisse, passant de 32,5 milliards de dollars en 1994 à 22,5 milliards actuellement ; le budget a retrouvé un équilibre ces trois dernières années ; les réserves de changes sont, quant à elles, recomposées atteignant 17,9 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2001. S'ils sont bien évidemment les fruits de la politique d'austérité menée par le gouvernement, ces résultats sont avant tout dû à l'évolution favorable du prix du baril de pétrole ces dernières années. Les autorités algériennes ont profité de cette embellie pétrolière pour constituer un fond de régulation en vue de soutenir la croissance dans les moments difficiles; 7 Milliards de dollars ont, par ailleurs, été alloué pour financer un programme de relance économique complémentaire à celui des réformes structurelles engagées. Ce programme participera notamment à la réduction du taux de chômage et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Le bien être de cette dernière doit en effet être interprété comme le premier facteur d'un développement durable. C'est donc en vertu de tous ces efforts que l'Algérie demande son adhésion au sein de l'O.M.C., en tant que pays démocratique désireux de doper la refonte de son économie et de s'impliquer davantage dans les échanges internationaux.
Accord d'association U.E. - Algérie
Un autre pas décisif de l'Algérie dans le cadre de son intégration à l'économie mondiale, est l'accord d'association avec l'Union européenne récemment entériné. Cet accord, dans sa partie commerciale, est l'illustration de la plus marquante de la nouvelle politique étrangère algérienne.
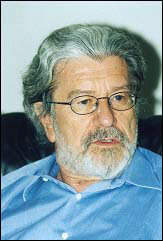
Les relations commerciales de l'U.E. avec l'Algérie sont bonnes. Près de 65% des exportations algérienne sont destinées à l'Europe ; cette dernière fournit, quant à elle, 58% des marchandises importées. La signature d'un accord de partenariat vient concrétiser davantage les liens qui unissent les deux côtes et offrent des perspectives prometteuses. Plusieurs points sont mis en exergue: un dialogue politique et économique régulier ; l'établissement progressif d'une zone de libre échange, en conformité avec les règles de l'O.M.C. ; des dispositions relatives à la liberté d'établissement, la libéralisation des services, la libre circulation des capitaux et l'application des règles communautaires de concurrence ; de dispositions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ; le renforcement de la coopération économique ; la coopération financière ; l'instauration d'un conseil d'association et d'un comité d'association disposant de pouvoirs de décision.d'association disposant de pouvoirs de décision.
Cet accord d'association s'inscrit notamment dans le prolongement du programme MEDA, principal élément de la coopération économique et financière du partenariat euro-méditerranéen. Il permet à l'U.E. d'apporter une aide financière et technique au pays du sud de la méditerranée et poursuit trois objectifs: renforcement de la stabilité politique et démocratique, création d'une zone de libre échange entre l'Union européenne et ses partenaires méditerranéens d'ici 2010 et développement de la coopération économique et sociale, prise en considération de la dimension humaine et culturelle.
" Le programme Meda, volet financier de la coopération euro-méditerranéenne se chiffre globalement à 5,5 milliards euro. En ce qui concerne l'Algérie, nous avons actuellement un stock d'environ 25 projets, dont la valeur globale atteindra en 2004 environ un demi-milliard. Actuellement, une vingtaine de projets est en cours d'exécution, la plus grande partie touchant les secteurs de réformes de structures: finances, banques, petites et moyenne entreprises. Mais nous sommes également engagés dans des projets de développement social et économique, d'appui à la société civile et nous donnons même une assistance à la modernisation de la police. ", explique Mr. Lucio Guerrato, ambassadeur de l'Union européenne en Algérie.
Parallèlement à l'accord d'association avec l'Union européenne, il faut souligner un autre outil de développement instauré par les pays du Maghreb eux-mêmes, l'U.M.A. L'Union du Maghreb Arabe, qui regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, travaille, en effet, pour qu'une zone de libre échange Maghrébine se mette en place d'ici quelques années, préparant ainsi l'instauration d'une Union douanière. " Pour l'Algérie, l'édification de l'Union du Maghreb Arabe constitue un objectif stratégique qui, par définition, ne peut être affecté par les difficultés conjoncturelles et les divergences ponctuelles qui peuvent exister entre les pays de l'UMA. La démarche de l'Algérie est dictée par le fait que la tendance au regroupement et la mise en synergie des potentialités est devenue une tendance universelle et une logique à laquelle le Maghreb ne peut longtemps échapper, au risque de se marginaliser et de s'exclure de la nouvelle configuration géopolitique mondiale. " déclare le Chef du gouvernement monsieur Benflis.
La promotion du commerce et de l'investissement

De son côté, l'Algérie a mis en place tout un arsenal de mesures concrète destinées à doper le commerce et à promouvoir les investissements. Mr. Chami, directeur général de la Chambre Nationale de Commerce et de l'Industrie (CACI) travaille dans ce sens et tente d'offrir une meilleure connaissance du marché intérieur, tant aux opérateurs nationaux qu'à l'investissement étranger. " Des missions exploratoires sont organisées pour identifier, à l'étranger, des hommes d'affaires qui recherchent des débouchés à leurs produits. Nous conduisons aussi des délégations étrangères qui recherchent des partenaires pour d'éventuels investissements ",explique Mr. Chami, qui remarque par ailleurs que: " L'ouverture du marché a quelquefois des aspects positifs ou négatifs. Pour les aspects positifs, les importations ont été rationalisées d'où la limitation du gaspillage, les prix à l'importation réduits. Ce qui a été constaté à travers les grands produits comme le café, le sucre, la semoule, etc. (…) Aujourd'hui, une multitude d'opérateurs et une forte concurrence ont tiré les prix vers le bas et amélioré la qualité du produit et du service".
La CACI est donc, dans ce cadre, un interlocuteur de choix.
Renforcer les liens entre les opérateurs nationaux et étrangers, tel est également la mission de l'office de promotion du commerce extérieur, le PROMEX. Mû par la conviction que les avantages comparatifs qu'offre l'économie nationale algérienne sont à exploiter, le directeur général de PROMEX, Mr. Khelifi remarque que " l'Algérie est le marché le plus important, le plus diversifié et le plus solvable de l'Union Maghrébine, avec un important potentiel industriel. ". La SAFEX, la Société Algérienne des Foires et Exportations, constitue un élément incontournable dans le cadre de la promotion du pays à l'étranger. Mr. Gasmi, directeur de la communication de la SAFEX estime qu'" aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'une autre politique, portée essentiellement sur la recherche de partenariat industriel créateur de richesses et d'emplois. ". La SAFEX est aussi parti prenante dans l'organisation de la Foire Internationale d'Alger
Si l'ouverture internationale présente à terme de nombreux avantages pour le développement de l'économie algérienne, beaucoup d'entrepreneurs fustigent la précipitation dans laquelle celle-ci est appliquée. Ainsi par exemple, l'accord d'association avec l'Union européenne ne manque pas d'inquiéter, dans la mesure où celui-ci s'articule essentiellement sur le démantèlement tarifaire. Cette décision en particulier ne manquera pas d'entraîner, à cours terme, des effets néfastes pour les entreprises nationales qui vont perdre des marchés jusque là protégés. Face à la réalité de cette menace, Mr. Abdelhamid Temmar, ancien ministre du commerce actuelement en charge de la privatisation, rassure et affirme qu'une forme de protection a été mise en place, qui offre la possibilité d'être encore protégé par une imposition de l'ordre de 48%. Cette taxe sera démantelée à raison de 12% l'année, ce qui donne la possibilité d'être encore protégé quelques années. L'Algérie se doit, durant ces prochaines années, de se mettre à niveau et devenir compétitif par rapport à la concurrence extérieure. Il n'empêche que pour un pays ayant été régi, durant de nombreuses années, par un régime autarcique, privilégiant le repli sur soi, les réflexes de la libre concurrence sont plus lent à mettre en œuvre.
CONCLUSION
Le nouveau dynamisme perçu dans l'économie algérienne, relève donc principalement d'un nouvel esprit d'entreprise porté par un cadre législatif plus souple, qui favorise l'initiative privée et l'émergence d'un marché concurrentiel. Forte de sa position géostratégique et de sa nouvelle politique d'ouverture, l'Algérie possède les atouts décisifs pour se hisser, à terme, parmi les pays développés. Les mesures adoptées par le gouvernement au cours de ces dernières années ont eu un effet positif sur les paramètres macroéconomiques, mais 97% des exportations proviennent toujours du secteur pétrolier. Une diversification de la production s'avère donc indispensable pour limiter les risques de dépendance. Par ailleurs, le remboursement de la dette, constitue un obstacle majeur au développement et à la diversification de l'économie. Avec de telles richesses en hydrocarbures, cette situation est difficile à comprendre pour une population frappée d'un taux de chômage record (30%) et aspirant à plus de considération de la part des autorités.
Durant longtemps, les investissements publics en matière de logement, d'hygiène, et d'infrastructures en tous genre ont cédé le pas aux importations de marchandises de bases. Les priorités doivent maintenant impérativement changer et aller à la résorption du chômage et du déficit considérable en logements, au développement d'un système éducatif de qualité et au renforcement en besoins de première nécessité, tel l'accès à l'eau courante. Profitant du contexte favorable de la conjoncture pétrolière, des réformes ambitieuses et des programmes d'envergures ont été mis en place par le gouvernement, afin de pallier cette situation inconfortable.
Dans ce cadre, l'apport de capitaux étrangers via l'investissement et les programmes d'aide structurel est vital pour une mise à niveau. Mais, face à un environnement social et politique encore lourdement marqué par ces dix dernières années d'insécurités, les investisseurs se méfient. Rendre confiance à ces dernier constitue donc un des autres grands défi de ce gouvernement ; défi qui passe nécessairement par la création de conditions stables et de structures transparentes. La récente signature du traité d'association avec l'Union européenne et les démarches pour l'adhésion à l'OMC, sont autant de signes qui manifestent aux investisseurs la ferme volonté du gouvernement algérien de rompre avec son passé tumultueux. Le Chef du Gouvernement Benflis affirme d'ailleurs: " Il est vrai que l'Algérie est passée par une étape difficile, mais elle est désormais résolument engagée sur la voie de la sortie définitive de la crise. Ceux qui assureront leur présence sur le marché algérien, à ce moment précis, prendront un avantage considérable sur leurs concurrents. Je ne sous estime pas le déficit d'image dont souffre mon pays, mais la meilleure stratégie de riposte à cette situation est d'inviter tous ceux qui s'intéressent au marché algérien à venir constater notre évolution. L'Algérie est maintenant désormais sur la voie de la modernité et du progrès ; croire dans les potentialités de ce pays, c'est faire un pari prometteur sur l'avenir.



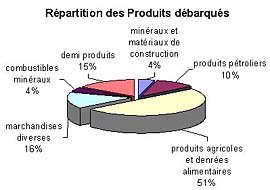


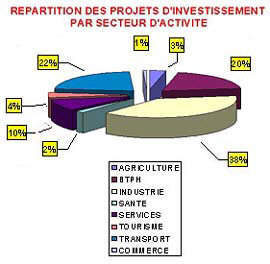
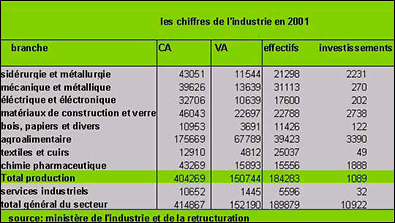



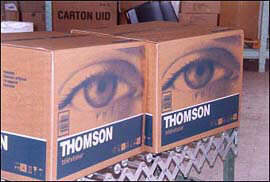






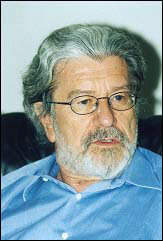

 M. BenflisChef du GouvernmentN/A
M. BenflisChef du GouvernmentN/A  Mr. Noureddine BoukrouhMinistre de la Participation et de la Coordination des RéformesN/A
Mr. Noureddine BoukrouhMinistre de la Participation et de la Coordination des RéformesN/A  Mr. Lucio GuerratoAmbassadeur de l'Union Européenne en AlgérieN/A
Mr. Lucio GuerratoAmbassadeur de l'Union Européenne en AlgérieN/A 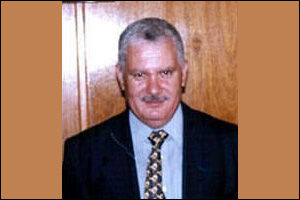 Monsieur Mustapha MerzoukPrésident directeur général du groupe GIPECGIPEC
Monsieur Mustapha MerzoukPrésident directeur général du groupe GIPECGIPEC  M. RACHID AMROUCHESecretaire General Khalifa GroupKhalifa Group
M. RACHID AMROUCHESecretaire General Khalifa GroupKhalifa Group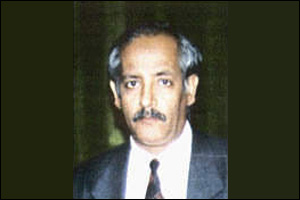 MONSIEUR Mohamed HOCINE AHRIZPrésident Directeur Général de la SAPTA SAPTA
MONSIEUR Mohamed HOCINE AHRIZPrésident Directeur Général de la SAPTA SAPTA  MONSIEUR GOUMIRI Président Directeur Général de SGCI Société de Garantie du Crédit
MONSIEUR GOUMIRI Président Directeur Général de SGCI Société de Garantie du Crédit 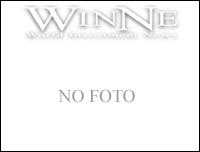 Monsieur MebarekDirecteur General de L'ansejANSEJ
Monsieur MebarekDirecteur General de L'ansejANSEJ 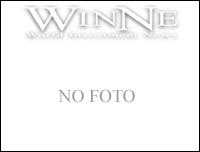 M. MenasraAncien Ministre de l'Industrie et de la ReconstructionN/A
M. MenasraAncien Ministre de l'Industrie et de la ReconstructionN/A 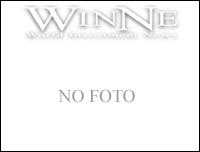 M. NazefSecrétaire Général de du ministère des transport N/A
M. NazefSecrétaire Général de du ministère des transport N/A 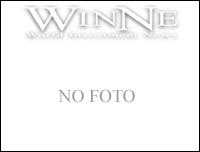 Madjid Baghdadli Directeur Général de l'Agence Nationale de Développment de l'InvestissementN/A
Madjid Baghdadli Directeur Général de l'Agence Nationale de Développment de l'InvestissementN/A 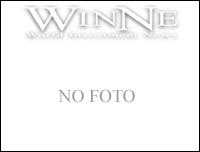 M. Aït YalaDirecteur General de Bya ElectronicN/A
M. Aït YalaDirecteur General de Bya ElectronicN/A 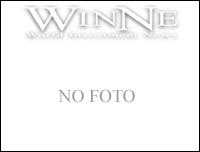 M. NouiouaPresident Directeur General ENORN/A
M. NouiouaPresident Directeur General ENORN/A 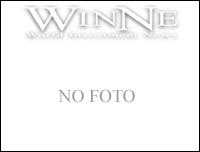 Monsieur Shrider Marar Président Directeur Général de ISPAT ANNABA N/A
Monsieur Shrider Marar Président Directeur Général de ISPAT ANNABA N/A 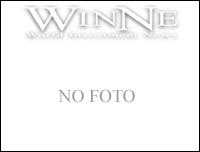 Monsieur SudreauDirecteur General TOTAL FINA ELFN/A
Monsieur SudreauDirecteur General TOTAL FINA ELFN/A 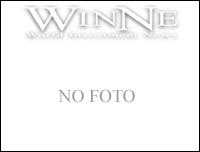 Monsieur HamimidMonsieur le Ministre de l'Habitat et de l'UrbanismeN/A
Monsieur HamimidMonsieur le Ministre de l'Habitat et de l'UrbanismeN/A  Algerie PostePosts and Telecommunications
Algerie PostePosts and Telecommunications Algeria TelecomTelecommunications
Algeria TelecomTelecommunications Banque de l’Agriculture et du Développement RuralBanks and Insurances
Banque de l’Agriculture et du Développement RuralBanks and Insurances BATI-ORConstruction and Infrastructure
BATI-ORConstruction and Infrastructure BELCOLIndustrial Glues
BELCOLIndustrial Glues BJSPEnergy
BJSPEnergy BKL IndustriesConstruction and Infrastructure
BKL IndustriesConstruction and Infrastructure Chambre Algérienne de Commerce et d'IndustrieTrade & Industry
Chambre Algérienne de Commerce et d'IndustrieTrade & Industry Société des Céramiques Algériennes SPAIndustry
Société des Céramiques Algériennes SPAIndustry Crédit Populaire D'AlgérienBanking
Crédit Populaire D'AlgérienBanking DHL International AlgérieTransport, Logistics and International Mail
DHL International AlgérieTransport, Logistics and International Mail L'EGSA ORANTransport and Civil Aviation
L'EGSA ORANTransport and Civil Aviation Entreprise Nationale de Charpente et ChaudronnerieMechanical and Metallurgical
Entreprise Nationale de Charpente et ChaudronnerieMechanical and Metallurgical E.N.N.A. (Établissement National de la Navigation Aérienne)Air navigation
E.N.N.A. (Établissement National de la Navigation Aérienne)Air navigation Entreprise Portuaire de AnnabaNavigation services
Entreprise Portuaire de AnnabaNavigation services FERPHOSMining
FERPHOSMining