|
Richesse, talent
et diversité
Depuis des temps très anciens et au regard
de l'aspect rudimentaire de leurs outils, les
artistes sculpteurs congolais ont toujours eu
un talent inné. Même si du point
de vue de l'élaboration sculpturale, les
formes de leurs créations ne remplissaient
pas toujours les proportions exigées par
les normes occidentales classiques de l'orthodoxie
sculpturale. Déjà, pendant la période
coloniale, de nombreux sculpteurs se sont distingués
par la qualité de leur travail.
Ainsi, vers les années 1930, au village
Kingoma, dans la banlieue nord de Brazzaville,
un certain Mayola, sculpteur talentueux attire
l'attention des Européens. L'artiste traduit
déjà dans ses œuvres la rencontre
de l'imaginaire avec le bois; dépassant,
précocement d'ailleurs, l'éternelle
reproduction du réalisme ou de la vie concrète.
Pour Mayola, reproduire des coqs, des pipes traditionnelles,
sculpter des bustes et autres masques tékés
est un jeu d'enfants. Vers les années 1940,
il laisse ce jeu à ses neveux Grégoire
Massengo et Benoît Konongo qu'il initia
à la sculpture. Mayola quitta le village
Kingoma, traversa le fleuve Congo pour s'installer
à Léopoldville (actuelle Kinshasa)
où la clientèle était plus
nombreuse. Après le départ de leur
maître et oncle, Grégoire Massengo
et Benoît Konongo continuèrent le
travail dans le même atelier. Massengo élabore
le système de représentation en
bas relief, avec des essences de bois léger,
facile à tailler et à colorer. Un
mélange de charbon de bois et d'huile de
palme donnait un noir idéal quant le bois
d'ébène venait à manquer.

 Rencontre
avec la civilisation européenne Rencontre
avec la civilisation européenne |
A l'évidence, ces réalisations
d'art attiraient les colons européens de
Brazzaville. Pour Luc Aka-Evy, professeur de lettres
et civilisation africaine à l'Université
de Brazzaville, " les circonstances de cet
intérêt européen vis à
vis de ces artistes congolais sont fort complexes.
D'un côté, les artistes et mécènes
européens adoptent diverses attitudes correspondant
à leurs préoccupations dominantes,
mais ils s'attachent aussi à sauver l'art
ancestral menacé de disparition par les
bouleversements politiques, économiques
et socioculturels. Soit encore, ils se préoccupent
d'initier les artistes congolais à de nouvelles
perspectives plastiques ou cherchent des formules
intermédiaires, destinées à
concilier l'originalité africaine avec
les techniques modernes ".
Quoi qu'il en soit, on ne s'étonne pas
que l'architecte français Roger Lelièvre
(alias Errel) s'arrange pour que Benoît
Konongo intègre autour des années
1945 la section " Arts appliqués "
de l'Ecole coloniale Edouard Renard de Brazzaville.
Il y affine sa propre technique surtout sur le
plan de la finition que les Européens maîtrisent
parfaitement. De son côté, Grégoire
Massengo découvre d'autres techniques.
Avec la recherche de nouveaux styles et la diversification
des thèmes, Konongo est obligé de
trouver constamment de nouvelles essences de bois.
Chaque essence ayant ses spécificités,
elle est adaptée à des créations
précises. Le polissage et la brillance
étant différents d'un bois à
un autre. Benoît Konongo et Grégoire
Massengo, qui entre temps ont séparé
leurs ateliers, ont découvert la beauté
d'autres essences comme le Wengué, le Kambala,
etc.
En mémoire à ces artistes, le village
de Kingoma qui est devenu un quartier de Brazzaville
porte maintenant le nom de " Massengo ".
Les deux frères Massengo et Konongo sont
aujourd'hui considérés comme les
pères fondateurs de la sculpture moderne
congolaise sur bois. Cette sculpture congolaise
a aussi subit l'influence de Bernard Mouanga-Nkodia,
célèbre vers les années 1959,
mais très influencé par l'empreinte
belge de l'école des Arts Saint-Luc de
Léopoldville.
 Très
peu d'ivoire dans la sculpture Très
peu d'ivoire dans la sculpture |
Traditionnellement, c'est le bois qui est le
plus utilisé dans la sculpture congolaise.
L'utilisation de l'ivoire et surtout son maniement
sont venus des artistes Bolobos de la rive gauche
du fleuve Congo; c'est à dire de la RDC.
Certains historiens pensent que l'ivoire n'a été
introduit dans la sculpture moderne congolaise
que entre 1950 et 1960. Aussi, il n'est pas exclu
que l'ivoire ait été utilisé
par les artistes sculpteurs des temps anciens.
Le travail sur l'ivoire ne s'est pas développé
dans la sculpture moderne, dû certainement
à la rareté de la matière
et aussi à la chasse à l'éléphant
interdite par le colonisateur.
Enfin, il y a la nouvelle génération
de sculpteurs qui a introduit le gigantisme. Ce
sont notamment Babindamana, Mongo-Etsion, Ndassa
et d'autres, qui exécutent des oeuvres
représentant des figures ou des personnes
grandeur nature et plus. Ces artistes ont aussi
révolutionné la sculpture moderne
du Congo en diversifiant le matériau. Ce
n'est plus seulement le bois qui est taillé,
c'est dorénavant aussi la pierre et le
moulage du plâtre. La sculpture congolaise
est maintenant un mélange de talents traditionnels
innés et d'orthodoxie occidentale.

|
 Une
peinture de renommée mondiale Une
peinture de renommée mondiale |
La peinture congolaise prend curieusement son
essor à peu près à la même
période que la littérature. Elle
exprime sa vitalité au début des
années 1955 avec les peintres Guy Léon
Fila, Eugène Malonga et Faustin Kitsiba.
L'opinion publique pense que la peinture congolaise
s'est développée grâce au
centre d'Art africain de Brazzaville, plus connu
sous le nom de l'Ecole de peinture de Poto-Poto.

Cette école fut créée en
1951 par le peintre français Pierre Lods.
Aujourd'hui, on retrouve dans les grands musées
du monde et les expositions internationales des
tableaux de grands maîtres de l'Ecole de
Poto-Poto. Ainsi sortiront de cette école
des grands noms de la peinture congolaise, tels
Zigoma, Ouassa, Iloki, Ondongo et le célèbre
Gotène, dont le coup de pinceau est tout
à fait original. Suivront ensuite les jeunes
Trigo Piula, Ouaboulet, Mongo, Makani et d'autres.
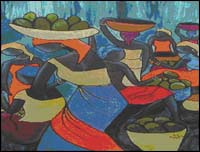
On trouve dans la peinture congolaise, toutes
les grandes classifications de styles: réalisme,
surréalisme, cubisme, abstrait, suggestif,
etc. Mais cette peinture se heurte à la
question d'approvisionnement en matériels
de travail. Il n'existe au Congo aucun magasin
spécialisé dans la vente de matériels
de travail pour les peintres, musiciens, sculpteurs,
etc.
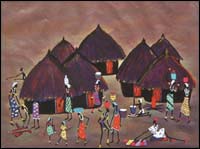
Tout est importé plus ou moins individuellement
par les artistes eux-mêmes. C'est certainement
un créneau à exploiter pour les
opérateurs économiques.
 Musique:
Un festival panafricain tous les 2 ans à
Brazzaville Musique:
Un festival panafricain tous les 2 ans à
Brazzaville |
Au Congo, la musique peut être subdivisée
en deux grands groupes: d'une part la musique
traditionnelle et d'autre part la musique dite
moderne. La musique traditionnelle, péjorativement
appelée " musique folklorique ",
est celle où l'on utilise des instruments
du terroir. Ce sont essentiellement, l'inévitable
Ngoma ( tam-tam), la Sanza, qui est une sorte
de guitare taillée dans un bois léger
et aussi les clochettes. Quant à la musique
moderne, elle qui requiert l'utilisation des instruments
électriques européens. Selon que
l'on se trouve dans l'une ou l'autre des 10 régions
administratives du Congo, on rencontre une variété
de musiques traditionnelles, dont les chansons
et aussi les danses traduisent l'état d'esprit
dans lequel on se trouve. Quand bien même
on ne comprend pas la langue utilisée dans
les chansons, le rythme des instruments et la
mélodie des chansons suffisent à
identifier les moments de joie ou le malheur.
Ainsi, il y a des danses et des chants pour le
mariage, la naissance, les veillées mortuaires,
etc. Avec le seul instrument de base qui est le
tam-tam, on peut obtenir plusieurs sons, selon
que l'instrument ait été taillé
dans tel bois plutôt que dans tel autre,
selon que le tam-tam soit petit, moyen ou grand.
De l'histoire récente de la musique traditionnelle,
on retiendra des grands noms de joueurs de Sanza
comme Antoine Moundanda, Papa Kourant, Loussialala,
etc. Aujourd'hui, le porte étendard de
la musique traditionnelle congolaise au niveau
international est un orchestre ballet appelé
" Les tambours de Brazza "
A propos de la musique moderne congolaise, on
peut dire qu'elle a été introduite
par le colonisateur portugais et ensuite français.
C'est donc auprès des colons que les premiers
musiciens congolais ont appris à manier
la guitare électrique, à chanter
dans un micro, ou tout simplement à jouer
du solfège. C'est avec la naissance du
très célèbre orchestre "
Bantous de la capitale ", en 1954, que la
musique moderne congolaise prend réellement
son essor. Au fil des ans, la pratique s'est étoffée
et le pays a produit des grands musiciens qui
se sont exportés sur tout le continent
africain. On peut citer quelques artistes tels,
Pamelo Mouka, Samba Ngo, Jean Serge Essou, Mountouri
Kosmos, Franklin Boukaka, etc. De grands orchestres,
comme " Extra Musica ", ont par ailleurs
acquis une grande popularité au delà
des frontières nationales. Les musiciens
congolais souffrent cependant énormément
du manque de promotion.
Aujourd'hui, c'est au niveau structurel que la
musique congolaise se distingue. En effet, il
s'organise tous les deux ans à Brazzaville
(depuis 1996), le Festival Panafricain de Musique.
Il s'agit d'un évènement initié
par l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA), orchestré conjointement avec le
gouvernement congolais. Il regroupe à chaque
occasion près de 2.000 musiciens du continent
entier. A chaque édition, ce sont plus
d'une quinzaine de pays qui envoient leurs représentants
à ce grand rendez-vous de la musique noire.
Le gouvernement congolais accorde une grande importance
à la tenue et surtout à la réussite
de ce festival. Une occasion de redorer le blason
du pays, terni par les guerres civiles, et surtout
une opportunité de montrer au monde que
le Congo a retrouvé le cours de la vie
normale d'un pays civilisé. En marge de
la prestation des musiciens et orchestres en concerts,
le Fespam est un lieu de réflexion, qui
réunit de nombreux musicologues autour
d'un thème différent à chaque
occasion. Une exposition d'instruments de musique
traditionnelle y est également présentée.
|

